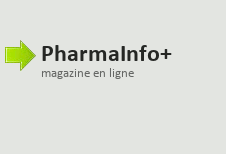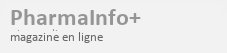La déficience intellectuelle
Définition de la déficience intellectuelle
La déficience intellectuelle est caractérisée par des limitations dans le fonctionnement intellectuel qui entraine le besoin de fournir une énorme quantité de soutien pour permettre à la personne de participer à des activités requérant le fonctionnement normal de l'être humain (Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo, et coll., 2008). Comme la perception de cette incapacité a considérablement changé au cours des deux dernières décennies, il convient d'examiner la déficience intellectuelle dans le contexte d'une compréhension plus générale de ce qu'est l'incapacité. Ce traitement aura, bien sûr, une portée très large qui se concentrera sur la compréhension du concept sous-jacent de la déficience intellectuelle.
La déficience intellectuelle est un type d'incapacité. Dans la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (Organisation mondiale de la Santé, 2001), le terme " incapacité " est un terme générique désignant les limitations du fonctionnement humain, dans lequel fonctionnement humain se rapporte simplement à toutes les activités de la vie normalement accomplies par une personne. Les limitations du fonctionnement sont catégorisées comme une " incapacité ". L'incapacité peut être issue de tout problème ayant occurrence dans une dimension ou plus parmi trois dimensions du fonctionnement humain: les structures anatomiques, les fonctions organiques, les activités et la participation.
En somme, selon la CIF, les structures anatomiques désignent les parties anatomiques du corps et les fonctions organiques désignent les fonctions physiologiques et psychologiques des systèmes organiques. Les problèmes survenant au niveau des fonctions organiques ou des structures anatomiques sont appelés déficiences. Les activités désignent les tâches ou les actions qu'une personne accomplit. Elles se rapportent aux aptitudes et aux habiletés permettant à un individu de s'adapter aux exigences et aux attentes de son environnement. On désigne les problèmes ayant occurrence dans cette dimension comme étant des limitations d'activités. La participation est définie comme l'" implication d'une personne dans une situation de vie réelle ". La participation est liée au fonctionnement de l'individu en société. Elle se rapporte aux rôles et aux interactions dans le domaine de la vie domestique, du travail, de l'éducation, des loisirs, de la spiritualité et des activités culturelles. Les problèmes qu'un individu connaît dans son implication dans les situations de la vie réelle sont appelés des restrictions de participation.
La déficience intellectuelle est donc une incapacité dans laquelle les déficiences cérébrales (ex. : fonctions organiques et structures anatomiques) causent des limitations d'activités et des restrictions de participation. De façon plus spécifique, les déficiences cérébrales associées à la déficience intellectuelle causent des limitations dans le fonctionnement intellectuel. Le fonctionnement intellectuel est un type de fonctionnement humain qui, selon la version 2002 du manuel Retard mental : définition, classification et systèmes de soutien de l'American Association on Mental Retardation (aujourd'hui l'American Association on Intellectual and Developmental Disabilities ou AAIDD) (Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter, Craig, Reeve et coll., 2002) est défini comme se rapportant à l'intelligence générale qui comprend le raisonnement, la planification, la résolution de problèmes, la pensée abstraite, la compréhension d'idées complexes, l'apprentissage rapide et l'apprentissage par expérience (p. 51).
Entre parenthèses, le terme " retard mental ", qui est le terme utilisé dans toutes les régions du monde, est peu à peu devenu stigmatisant et de plus en plus rejeté par les avocats, entres autres. Les membres du comité de terminologie et de classification de l'AAIDD ont récemment proposé que le terme " déficience intellectuelle " soit privilégié pour décrire l'état de fonctionnement historiquement désigné par le terme " retard mental ". Tout en laissant entendre que le terme déficience intellectuelle " couvre la même population d'individus ayant auparavant reçu un diagnostic de retard mental de même nombre, de même genre, de même niveau, de même type et de même durée et les besoins de ces personnes en matière de services et de mécanismes de soutien personnalisés " (p. 116), Schalock et ses collègues ont également reconnu que le terme " déficience intellectuelle " est plus efficace pour " refléter le concept modifié de l'incapacité proposée par l'AAIDD et l'OMS " (Schalock, Luckasson, Shogren, Borthwick-Duffy, Bradley, Buntix et coll., 2007, p. 120). Au fond, cette modification de la terminologie ramène les États-Unis en harmonie avec une grande partie du reste du monde, où le terme " déficience intellectuelle " a été adopté et est utilisé depuis plus longtemps.
La définition du retard mental/de la déficience intellectuelle présentée dans la version 2002 du manuel, au sujet de laquelle Schalock et coll. (2007) laissent entendre qu'elle " restera actuellement en vigueur et dans un avenir rapproché ", définit la déficience intellectuelle comme étant:
... une incapacité caractérisée par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif qui se manifeste dans les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques. Cette incapacité survient avant l'âge de 18 ans (p. 3).
La déficience intellectuelle fait partie d'un ensemble d'incapacités causées par une déficience du système nerveux central qui se manifestent par des limitations dans le fonctionnement cognitif général. Cet ensemble d'incapacités est de plus en plus désigné par un terme plus générique, soit les déficiences cognitives. La cognition est le processus mental de la connaissance, comprenant des aspects comme la conscience, la perception, le raisonnement et le jugement. Parmi les autres déficiences cognitives se trouvent les traumatismes crâniens, les troubles de l'apprentissage et la démence associée à la maladie d'Alzheimer. La déficience intellectuelle se distingue des autres déficiences cognitives en raison de facteurs comme la portée de la déficience (ex. : globale) et l'âge d'apparition (ex. : avant l'âge de 18 ans). Comme la déficience intellectuelle se manifeste au cours de la période de croissance (c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans), elle est également considérée comme un trouble du développement. Le trouble du développement est une catégorie non diagnostiquée désignant les personnes ayant à la fois des déficiences cognitives et des incapacités physiques, et dont le trouble
- est apparue dans l'enfance (période de croissance comprise entre la naissance et l'âge de 18 ans);
- constitue un défi important par rapport au fonctionnement normal; et
- est d'une durée indéterminée (Thompson et Wehmeyer, 2008)
La gamme et le type de déficiences cérébrales qui peuvent occasionner une détérioration du fonctionnement intellectuel sont nombreux et varient, tout comme les causes ou l'étiologie de ces déficiences. La 10e édition de Retard mental : définition, classification et systèmes de soutien (Luckasson et coll., 2002) traite des enjeux liés à l'étiologie et à la prévention de la déficience intellectuelle et offre un inventaire pratique des symptômes et des types de déficiences neuronales (les lecteurs sont priés de s'y rapporter pour plus de détails). Mais en somme, l'étiologie est définie comme un concept multifactoriel composé de quatre catégories de facteurs de risque (biomédicaux, sociaux, comportementaux et éducationnels) qui interagissent dans le temps, y compris au cours de la vie d'une personne et à travers les générations, des parents aux enfants " (Luckasson et coll., 2002, p. 123). En utilisant cette approche de l'étiologie, les praticiens sont en mesure de décrire les facteurs de risque qui contribuent à influencer le fonctionnement, et donc de déterminer des stratégies et des mesures préventives afin de les réduire. Les facteurs biomédicaux sont ceux qui sont liés aux processus biologiques, comme la santé maternelle et les troubles génétiques. Les facteurs sociaux comprennent les interactions familiales et sociales et des variables, comme le manque d'accès aux soins de santé et la négligence parentale. Les facteurs de risque comportementaux comprennent les comportements qui peuvent contribuer à limiter le fonctionnement, comme la consommation de drogues des parents et l'abandon. Finalement, les facteurs éducationnels déterminent l'accessibilité aux expériences de formation qui appuient les habiletés d'adaptation, comme un soutien familial inadéquat et l'éducation spécialisée. En déterminant l'étiologie, il est possible d'harmoniser des mesures préventives de soutien afin de soulager l'impact de la déficience intellectuelle.
Il existe trois types de prévention de nature générale: primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire consiste en la prévention d'une situation qui peut mener directement au développement d'un retard mental (ex. : usage de drogues par la mère). La prévention secondaire " consiste en la prise de mesures visant à empêcher une condition existante de causer un retard mental " (Luckasson et coll., 2002, p. 137). Finalement, la prévention tertiaire comprend la mise en œuvre de mesures afin de réduire la déficience provoquée par la prévention secondaire et les facteurs étiologiques. L'étiologie de la déficience intellectuelle peut sembler sans importance ou s'avérer essentielle lorsqu'il est question d'intervention, mais il est néanmoins certain que la connaissance de l'étiologie est importante dans le soutien prodigué aux personnes avec ou sans déficience afin qu'elles obtiennent de meilleurs résultats en matière de santé, y compris un fonctionnement intellectuel amélioré.
Selon la version 2002 du manuel de l'AAIDD, la déficience intellectuelle est mise en évidence par la faible compatibilité entre les capacités de l'individu et le contexte dans lequel il doit fonctionner. Une capacité désigne l'habileté à effectuer une tâche; dans le cas présent, une tâche mentale, cognitive ou intellectuelle. Comme la déficience intellectuelle se manifeste par des limitations dans le fonctionnement intellectuel d'un individu, mises en évidence par la faible compatibilité de ses capacités et du contexte, l'" incapacité " n'est pas perçue comme étant intrinsèque à la personne, mais plutôt en tant que " fonction " d'une compatibilité entre les capacités de l'individu et les attentes en matière d'activité et de participation issues du contexte. Cela ne veut pas dire qu'en assurant une meilleure compatibilité entre les capacités d'un individu et le contexte, par le biais de mécanismes de soutien environnementaux ou par l'instruction, une déficience sous-jacente au niveau d'une fonction organique (ex. : déficience cérébrale) sera automatiquement résolue. Il s'agit simplement d'une reconnaissance du fait que la déficience intellectuelle n'est pas définie par la déficience cérébrale en soi, mais par le fonctionnement de la personne (ex. : la compatibilité entre la capacité de la personne et le contexte).
De plus, comme mentionné auparavant, l'une des caractérisques de la déficience intellectuelle est qu'elle se distingue des autres déficiences cognitives de par sa nature globale. La déficience intellectuelle désigne les limitations du fonctionnement intellectuel se manifestant par des limitations d'activité et des restrictions de participation dans toutes les sphères d'activités de la vie et du fonctionnement humain.
En résumé, la déficience intellectuelle désigne donc une incapacité se manifestant par des limitations dans le fonctionnement intellectuel (raisonnement, planification, résolution de problèmes, pensée abstraite, compréhension d'idées complexes, apprentissage rapide et apprentissage par expérience) liées à des limitations d'activité, associées à des restrictions de participation et causées par des déficiences cérébrales ou des facteurs étiologiques précis.
Le modèle de la relation entre la personne et le contexte suggère que le succès du fonctionnement humain découle de la relation entre la capacité de la personne, soulignant ses forces personnelles, et le contexte, soulignant le soutien défini comme des stratégies, des ressources et des activités permettant l'amélioration du fonctionnement humain. Ce modèle suppose que les limitations dans les forces personnelles peuvent être, à tout le moins, partiellement compensées par le soutien, et que la cause du mauvais fonctionnement est probablement le manque de soutien ou de possibilités de participation.
- Des déficits aux habiletés humaines
Historiquement, la déficience intellectuelle a d'abord été définie en fonction de déficits de performance. Alors que le diagnostic et la classification de la déficience intellectuelle continuent d'ex... - Diagnostic et classification de la déficience intellectuelle
La définition de l'AAIDD reflète trois éléments définitoires fondamentaux de la déficience intellectuelle qui ont traversé le temps et les frontières et qui sont employés dans l'établissement d'un dia... - Déficience intellectuelle et réadaptation
Les modèles fonctionnels de l'AAIDD et de la CIF de la déficience intellectuelle mettent l'accent sur le rôle que les mécanismes de soutien jouent pour combler l'écart entre la capacité des personnes ... - Conclusions
Il est impossible de saisir dans ce chapitre tous les aspects de l'état de fonctionnement que l'on nomme la déficience intellectuelle, toutes les forces et les besoins en soutien des personnes ayant u...