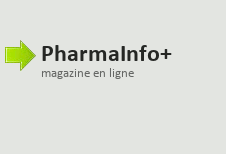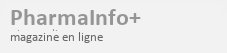Diagnostic et classification de la déficience intellectuelle
La définition de l'AAIDD reflète trois éléments définitoires fondamentaux de la déficience intellectuelle qui ont traversé le temps et les frontières et qui sont employés dans l'établissement d'un diagnostic et d'une classification des individus, habituellement au sein de systèmes de prestation de services:
- d'importantes limitations dans le fonctionnement intellectuel,
- des restrictions comportementales dans l'adaptation aux exigences de l'environnement, et c) l'identification/le diagnostic avant l'âge de 18 ans (Luckasson et coll., 2002)
Bien qu'il s'agisse d'une question de plus en plus contestée, la méthode communément acceptée de détermination des limitations du fonctionnement intellectuel continue d'être l'administration de tests d'intelligence d'où l'on obtient un niveau de quotient intellectuel ou QI. Tout en gardant à l'esprit les forces et les faiblesses de chaque évaluation et la marge d'erreur de mesure, le diagnostic de la déficience intellectuelle est fondé sur des niveaux de quotient intellectuel individuels se situant approximativement à deux écarts types au-dessous de la moyenne de l'ensemble de la population (Luckasson et coll., 2002).
Toutefois, comme cela a été le cas pendant près d'un demi-siècle, le diagnostic de la déficience intellectuelle ne peut s'appuyer uniquement sur le quotient intellectuel. Le second élément du diagnostic et de la classification comprend les limitations dans le comportement adaptatif. Le comportement adaptatif désigne " l'ensemble des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques apprises par les individus pour leur permettre de fonctionner dans la vie quotidienne " (Luckasson, 2002, p. 14). Le comportement adaptatif se rapporte à la capacité d'un individu de répondre et de s'adapter quotidiennement aux exigences de son environnement. Semblable à celles du fonctionnement intellectuel, les importantes limitations dans le comportement adaptatif sont définies par des scores de mesures normalisées d'au moins deux écarts-types sous la moyenne générale ou à partir d'un instrument d'évaluation normalisé pour l'un des trois types de comportement adaptatif (conceptuel, social et pratique). Le troisième élément, en termes de diagnostic, est constitué des définitions de la déficience intellectuelle qui maintiennent une perspective développementale. Comme il en a été question auparavant, la déficience intellectuelle est considérée comme une déficience développementale, car elle apparait au cours de la période de croissance (avant l'âge de 18 ans) et parce que le diagnostic ne peut être établi que si les limitations dans le fonctionnement humain se manifestent au cours de cette période. Les trois éléments définitoires, les limitations importantes dans le fonctionnement intellectuel, les restrictions comportementales dans l'adaptation aux exigences environnementales et l'identification/le diagnostic avant l'âge de 18 ans, doivent être présents pour permettre un diagnostic.
Une importante modification des questions relatives à la classification de la déficience intellectuelle a émergé au cours des dernières années. Traditionnellement, les systèmes de classification tournaient autour de la gamme des quotients intellectuels obtenus par les individus qui répondaient au critère d'un QI se situant à deux écart-types ou plus au-dessous de la moyenne. Le schème de classification le plus commun de ce type consistait à regrouper les individus selon leur QI dans l'un des quatre sous-groupes suivants: léger (QI de 70 à 55), moyen (QI de 55 à 40), grave (QI de 40 à 25) et profond (QI de 25 et moins). Toutefois, ces systèmes de classification étaient souvent variables et dépendaient du système dans lequel les individus étaient évalués et classifiés. Par exemple, dans un système de classification parallèle au sein des établissements d'enseignement, les catégories étaient : éducable, semi-éducable, grave et profond (inéducable). La version 2002 du manuel de classification de l'AAIDD (Luckasson et coll., 2002) proposait quatre niveaux d'intensité du soutien (intermittent, limité, important, intense), dont le but n'était pas de former une classification comme celle que les quatre niveaux de retard mental (léger, moyen, grave, profond) avait formée. Actuellement, bien que les systèmes traditionnels de classification soient encore en usage, on ne s'entend toujours pas sur la manière la plus adéquate de classifier les individus de cette population et, par ailleurs, si cela s'avère utile et nécessaire.