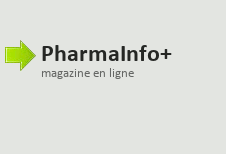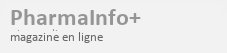Conclusions
Il est impossible de saisir dans ce chapitre tous les aspects de l'état de fonctionnement que l'on nomme la déficience intellectuelle, toutes les forces et les besoins en soutien des personnes ayant une déficience intellectuelle, ou encore tout ce que comporte l'expérience de vivre avec une déficience intellectuelle. Le but de cet article était plutôt de présenter une introduction à la perception de la déficience intellectuelle et de la définir dans le contexte de modèles comme la CIF; de présenter les types de capacités cognitives pouvant être touchées par une déficience cérébrale causant une déficience intellectuelle; le potentiel de renforcement de la capacité en présence d'une telle déficience; et la méthode de diagnostic et de classification du retard mental.
En guise de conclusion, il est bon de revenir sur la version 2002 du manuel Retard mental : définition, classification et systèmes de soutien de l'AAIDD qui fait état de cinq postulats à considérer lorsque l'on applique la définition:
- Les limitations dans le fonctionnement actuel doivent tenir compte des environnements communautaires typiques du groupe d'âge de la personne et de son milieu culturel.
- Une évaluation valide tient compte à la fois de la diversité culturelle et linguistique de la personne ainsi que des différences sur les plans sensorimoteurs, comportementaux et de la communication.
- Chez une même personne, les limitations coexistent souvent avec des forces.
- La description des limitations est importante notamment pour déterminer le soutien requis.
- Le fonctionnement général d'une personne présentant une déficience intellectuelle s'améliore généralement si elle reçoit un soutien adéquat et personnalisé sur une période prolongée. (Luckasson, 2002, p. 93).
Ces postulats ont été établis parce que les auteurs du manuel ne souhaitaient pas que l'on interprète leur manuel hors du contexte des croyances sous-jacentes à ces postulats, et il s'avère pertinent de conclure en citant brièvement la signification de chacun d'eux dans le cadre de notre tentative de compréhension de la déficience intellectuelle.
Premièrement, le fait que " les limitations dans le fonctionnement actuel doivent tenir compte des environnements communautaires typiques " met l'accent sur le critère selon lequel le fonctionnement d'un individu est comparé et observé dans des environnements communautaires typiques, comme son domicile ou son établissement d'enseignement, parmi des pairs du même âge et provenant de milieux linguistiques et culturels semblables. L'aspect probablement le plus " incapacitant " des anciens modèles de services offerts aux personnes ayant une déficience intellectuelle est le fait que celles-ci étaient perçues hors du contexte du fonctionnement humain normal et hors de l'existence humaine traditionnelle. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont été, pour la plus grande partie des deux siècles derniers, séparées de leurs collectivités et condamnées à vivre en institutions, pratiquement devenues des entrepôts; elles ne se sont vues offrir que des emplois dans des milieux de travail collectifs et peu rémunérés; et elles ont été instruites dans des contextes scolaires distincts et inéquitables. Ces tendances ont été renversées, à partir du moment où l'on s'est penché sur des mécanismes de soutien axés sur la vie dans la collectivité; sur des modèles reconnus, personnalisés, ainsi que sur des modèles d'emploi autonome voués à promouvoir de véritables emplois en échange d'un vrai salaire; sur la prestation de l'enseignement dans une classe d'enseignement général axée sur l'accessibilité au curriculum d'enseignement général et à l'acquisition d'aptitudes de vie fonctionnelles, et ainsi de suite.
Deuxièmement, le postulat concernant la nécessité des évaluations, pour être valides, de tenir compte de la diversité culturelle et linguistique, de même que des différences sur les plans sensorimoteurs, comportementaux et de la communication illustre le fait qu'un nombre disproportionné de personnes provenant de collectivités économiquement défavorisées et marginalisée, y compris les personnes issues de groupes minoritaires ethniques ou raciaux, de groupes d'immigrants, et autres, sont susceptibles d'être identifiées comme ayant une déficience intellectuelle. Ce nombre s'explique en partie par les circonstances de leur vie et les possibilités s'offrant à elles, ou leur absence, mais aussi en fonction du fait que les méthodes que l'on utilise pour déterminer la déficience intellectuelle et les outils consacrés à ces fins ne tiennent pas suffisamment compte de la vaste diversité d'individus qui découlent de facteurs culturels, linguistiques, ethniques et économiques.
Troisièmement, le postulat selon lequel les limitations coexistent souvent avec des forces explique simplement le fait que, depuis trop longtemps, les seules caractéristiques reconnues en ce qui concerne les personnes ayant une déficience intellectuelle étaient leurs limitations. Cependant, comme le mouvement d'autonomie sociale le rappelle, les individus présentant une déficience intellectuelle sont des " personnes avant tout " et elles possèdent toutes des forces et et des faiblesses qui requiert un soutien. Les modèles de la déficience intellectuelle de la CIF et de l'AAIDD nécessitent que l'on passe de l'ancienne compréhension du déficit à de nouvelles façons de concevoir la déficience intellectuelle qui tiennent compte des forces, des besoins de soutien et du contexte.
Le quatrième postulat, traitant du profil de soutien nécessaire, met simplement en évidence le fait que la détermination de la déficience intellectuelle devrait naturellement mener à l'identification des mécanismes de soutien requis et non pas uniquement à l'identification des limitations. En d'autres mots, le diagnostic n'est pertinent que s'il conduit à l'adoption de mécanismes de soutien qui améliorent l'existence de la personne. La stigmatisation associée à l'étiquette " déficience intellectuelle " n'est pas aussi importante que celle qui est associée aux termes plus anciens, y compris au terme " retard mental ", mais elle est encore assez considérable pour obliger les praticiens à soupeser les avantages du diagnostic, à cataloguer les inconvénients bien réels et à poursuivre leur diagnostic seulement si les avantages l'emportent clairement sur les inconvénients.
Finalement, le cinquième postulat à propos des résultats positifs pour les personnes qui reçoivent un soutien personnalisé pendant une période prolongée souligne à la fois l'incidence considérable que de tels mécanismes de soutien personnalisé peuvent avoir sur le fonctionnement des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais également sur le fait que celles-ci sont capables, avec suffisamment de soutien, de mener des existences de qualité et de contribuer à la société par leur présence et leur productivité. Le fait de juger dans quelle mesure ceci ne se conforme pas à la réalité actuelle serait de porter le blâme sur le système de soutien en place pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, et non sur les personnes elles-mêmes. La prestation de tels mécanismes de soutien par le biais de stratégies traditionnelles et innovatrices de réadaptation devrait contribuer à assurer une meilleure qualité de vie aux personnes ayant une déficience intellectuelle.