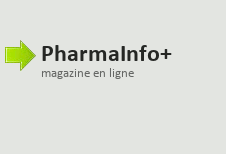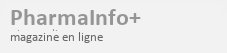Réhabilitation
- La déficience intellectuelle
- La déficience intellectuelle est caractérisée par des limitations dans le fonctionnement intellectuel qui entraine le besoin de fournir une énorme quantité de soutien pour permettre à la personne de participer à des activités requérant le fonctionnement normal de l'être humain (Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo, et coll., 2008). Comme la perception de cette incapacité a considérablement changé au cours des deux dernières décennies, il convient d'examiner la déficience intellectuelle dans le contexte d'une compréhension plus générale de ce qu'est l'incapacité. Ce traitement aura, bien sûr, une portée très large qui se concentrera sur la compréhension du concept sous-jacent de la déficience intellectuelle.
- Dysphagie (difficulté à avaler ou gêne dans le passage de la nourriture de la bouche vers l'estomac)
- Les personnes atteintes de dysphagie ou de difficulté à avaler se plaignent souvent du fait qu'elles toussent en mangeant, qu'elle ont l'impression que la nourriture « colle » dans leur gorge, qu'elles doivent se râcler la gorge en mangeant, qu'elles ont l'impression qu'une quantité de nourriture est restée dans leur bouche ou leur gorge après la déglutition et d'autres malaises liés à l'alimentation. Elles évitent parfois de manger des aliments qui leur sont plus difficiles à avaler. L'apparition du problème est parfois si lent que certains patients ne sont pas conscients de leur problème. La dysphagie est fréquente chez les personnes âgées ayant subi un accident neurologique, comme un accident vasculaire cérébral, ou un dommage structurel, comme un traitement pour un cancer de la tête et du cou. Les enfants et les nourrissons peuvent également être atteints de problèmes de déglutition en raison d'une anomalie congénitale ou d'un trouble du développement neurologique acquis (Arvedson et Lefton-Greif 1998; Logemann 1998). La plupart des renseignements contenus dans ce chapitre s'appliquent aux enfants et aux adultes dysphagiques, mais pas aux nourrissons dont le contrôle buccal n'est pas encore complètement développé.
- La dystrophie myotonique de Steinert
- La dystrophie myotonique de Steinert est une maladie génétique autosomique dominante associant une dystrophie musculaire, une myotonie et des anomalies multisystémiques. C'est la plus fréquente des maladies neuromusculaires de l'adulte. Sa prévalence est d'environ 5 cas pour 100 000 habitants.
- Éducation des adultes, déficiences intellectuelles et incapacités développementales apparentées
- On a choisi une large approche pour étudier l'éducation des adultes dans le domaine des déficiences intellectuelles et des incapacités développementales, car l'étendue et la variabilité de la performance chez les personnes vivant avec de telles incapacités sont effectivement très larges. La déficience intellectuelle est perçue comme un problème de croissance cognitive interrompue se manifestant dans les premières années du développement, soit dès la petite enfance. Elle est non seulement associée à la déficience cognitive, mais également à une vaste gamme de limitations sociales dans des domaines relatifs aux compétences sociales et aux stratégies d'adaptation (Brown 2007). La définition de la déficience intellectuelle est plus approfondie dans cette encyclopédie sous l'entrée déficience intellectuelle (site Web de l'Encyclopédie internationale de la réadaptation).
- L'épilepsie : les encéphalopathies épileptiques
- La crise épileptique est liée à une activité excessive et paroxystique (décharge soudaine et brève) des cellules nerveuses cérébrales. On parle d'épilepsie lorsqu'il y a récurrence (récidive) chronique des crises. L'épilepsie est un problème médical majeur de l'enfance puisque sa prévalence est de 4 à 5 %. Ne sera considérée ici que l'épilepsie venant se surajouter à une déficience motrice par lésion cérébrale ou entrant dans le cadre de maladies épileptiques particulières. « Comitialité » et « épilepsie » sont synonymes.
- L'épuisement professionnel des enseignants en Grèce
- L'épuisement professionnel est un syndrome lié au travail qui découle de la perception par une personne d'une incohérence entre les efforts fournis et les récompenses qu'elle reçoit (Friedman 1995). On observe l'épuisement professionnel principalement chez les personnes qui interagissent directement avec d'autres personnes, comme les enseignants ou les médecins. Cet état est caractérisé par un épuisement affectif et physique, ainsi que par plusieurs symptômes psychologiques comme la nervosité, l'anxiété, la dépression et une faible estime de soi (Farber 1991). Il faut souligner que l'épuisement professionnel vécu par les enseignants constitue un processus et non une simple constatation, de sorte que chaque individu tente de s'en sortir à sa manière (Farber 1983). L'épuisement professionnel provoque généralement une diminution du bien-être et une incapacité à fonctionner correctement dans la vie quotidienne (Burke et Greenglass 1995).
- L'éthique en réadaptation
- La réadaptation consiste, par (ma) définition, en la prestation de soins de santé à des personnes ayant des incapacités permanentes ou temporaires dans le but de les aider à apprendre comment surmonter leurs incapacités, « incapacité » signifiant ici une réduction de la capacité d'accomplir des activités personnelles significatives et/ou importantes sur le plan social en raison d'un ou de nombreux problèmes de santé (Organisation mondiale de la Santé 2001). À ce titre, la réadaptation est en proie à des problèmes éthiques, qui sont fréquemment perçus dans le milieu de la santé comme une tension entre deux options ou plus de mesures de soins de santé moralement défendables, y compris la non-intervention (Hebert 1996). Le principal fondement d'un problème éthique – que l'on nomme un problème bioéthique dans le contexte de la santé – est souvent perçu comme un conflit de valeurs défendables ou de principes moraux relatifs aux mesures de soins de santé possibles relativement à une situation clinique particulière (Beauchamp et Childress 2001).