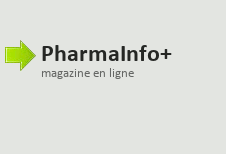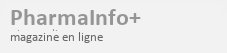L'éthique en réadaptation
Introduction
La réadaptation consiste, par (ma) définition, en la prestation de soins de santé à des personnes ayant des incapacités permanentes ou temporaires dans le but de les aider à apprendre comment surmonter leurs incapacités, « incapacité » signifiant ici une réduction de la capacité d'accomplir des activités personnelles significatives et/ou importantes sur le plan social en raison d'un ou de nombreux problèmes de santé (Organisation mondiale de la Santé 2001). À ce titre, la réadaptation est en proie à des problèmes éthiques, qui sont fréquemment perçus dans le milieu de la santé comme une tension entre deux options ou plus de mesures de soins de santé moralement défendables, y compris la non-intervention (Hebert 1996). Le principal fondement d'un problème éthique – que l'on nomme un problème bioéthique dans le contexte de la santé – est souvent perçu comme un conflit de valeurs défendables ou de principes moraux relatifs aux mesures de soins de santé possibles relativement à une situation clinique particulière (Beauchamp et Childress 2001).
Un exemple typique de problème bioéthique, qui relève de la justice dans certaines juridictions, est la tension qui existe entre l'avortement et la poursuite d'une grossesse en présence d'un fœtus malformé et qui a récemment fait l'objet d'un débat relativement à l'éthique dans la prévention du handicap congénital (Edwards 2005). On a envisagé et mis en œuvre diverses manières de régler ou de résoudre de tels problèmes bioéthiques, dont les mieux établies sont le conséquentialisme et l'utilitarisme, qui tiennent compte des conséquences, la déontologie, qui tient compte des devoirs, et l'éthique de la vertu, qui tient compte des intentions (Beauchamp et Childress 2001). Il est à noter que l'éthique est souvent considérée comme ayant également trait à des infractions aux lois et aux règlements, comme la violation de la confidentialité, de même que la transgression des limites sexuelles et des limites professionnelles par des prestataires de soins de santé, dont se chargent des institutions comme les comités de discipline professionnelle. Le présent article ne traitera pas de ces violations, puisqu'elles sont déjà bien définies dans les codes de déontologie disponibles (Commission on Rehabilitation Counselor Certification 2001).
Objectif et méthodologie
L'objectif de cet article est de passer en revue les problèmes éthiques en réadaptation et leurs solutions rationnelles au moyen d'un contexte bioéthique normalisé, d'exemples issus de la documentation, ainsi que de vignettes de cas fictifs, mais réalistes. Bien que cet article ne constitue aucunement un examen complet de ces problèmes et de leurs solutions, d'autres études à ce sujet se trouvent dans la documentation récente (Reid and McReynolds 2007), l'intention de cet article est d'examiner les principaux problèmes bioéthiques en réadaptation et leurs solutions rationnelles d'une manière suffisamment détaillée pour aider les lecteurs à comprendre les principaux enjeux de la bioéthique de la réadaptation.
Le concept standard de la bioéthique qui sera appliqué ici est le principisme, qui n'est pas sans présenter ses propres enjeux (Rudnick 2001), mais qui s'avère tout de même utile, probablement plus encore lorsqu'il est associé au plus grand nombre de débats possibles. Ceci nécessite, en retour, des processus institutionnels et interpersonnels pour appuyer le plein pouvoir de participation de – et la génération de solutions par – tous les intervenants touchés (Rudnick 2002a; Rudnick 2007a). On ne peut douter que le principisme puisse mettre davantage l'accent sur le niveau individuel et clinique plutôt que sur les niveaux organisationnel et sociétal de la bioéthique, comme il en est question dans les récents écrits à ce sujet (Purtilo, Jensen and Brasic Royeen 2005), mais à titre d'illustration, un discours principiste devrait suffire.
Selon le principisme, il y a trois ou quatre principes moraux fondamentaux contrôlant l'action morale qui peuvent entrer en conflit entre eux (ou au sein d'un même principe), causant ainsi un problème éthique. Ces principes sont:
- le respect de l'autonomie (autonomisation)
- la bienfaisance (faire le bien)
- la non malfaisance (faire peu ou pas de mal, qui peut être combinée à la bienfaisance comme forme d'équilibre entre le plus grand bien et le moindre mal)
- la justice (l'impartialité, particulièrement envers les autres personnes impliquées ou touchées, par l'affectation des ressources par exemple)
De plus, le principisme tient compte du contexte ou des circonstances, comme la culture. Les problèmes bioéthiques en réadaptation seront analysés en relation avec les conflits au sein de ces principes, et en marge de ceux-ci, dans le contexte de situations de réadaptation. Il est à noter que certains problèmes bioéthiques émergeant de certaines conditions de traitement peuvent s'avérer hors de propos ou sans rapport avec la réadaptation, comme ceux qui touchent les situations de phase terminale, puisque cette discipline suppose que l'espérance de vie du client n'est pas extrêmement réduite (et si tel est le cas, ce sont plutôt des soins palliatifs qui sont habituellement offerts, plutôt que des services de réadaptation).
Les problèmes bioéthiques en réadaptation et leurs solutions rationnelles
Certains problèmes bioéthiques en réadaptation traitent du conflit entre la bienfaisance et la non malfaisance. Par exemple, il est possible que l'usage d'une prothèse de membre inférieur soit avantageuse pour un patient ayant subi une amputation de la jambe, car elle facilite la marche autonome. Pourtant, celle-ci peut lui nuire en lui causant de la douleur et d'autres complications dans la région du segment amputé, alors que l'usage d'un fauteuil roulant aurait l'avantage de lui éviter cette douleur et ces complications, et toutefois lui nuire en s'avérant une entrave à la marche autonome. La solution à ce problème est habituellement déterminée en faisant appel au principe du respect de l'autonomie, principe selon lequel le patient décide s'il utilisera une prothèse ou un fauteuil roulant, bien que cette solution ne soit pas totalement défendable si le patient n'est pas mentalement apte à prendre de telles décisions, comme cela se produit dans le cas de patients ayant subi un traumatisme crânien (dans ce cas, on s'attend à ce que le mandataire du patient prenne la décision dans l'intérêt de ce dernier, bien qu'il soit très difficile de mettre en œuvre de telles interventions de réadaptation en l'absence du consentement du patient). Dans de tels cas, la solution pourrait être de vérifier si le patient, lorsqu'il est apte, préfère davantage l'autonomie à l'évitement de la douleur et autres problèmes de santé, ou vice versa, dans la mesure où cette information est accessible (ex. : dans une directive préalable faisant état des souhaits d'une personne concernant sa santé). Sinon, la solution pourrait être de tenir compte de ce que préfèrent la plupart des personnes présentant une telle incapacité, particulièrement celles dont les situations sont semblables sur le plan d'importants facteurs contextuels, comme l'âge, le sexe, et plusieurs autres.
D'autres problèmes bioéthiques ont trait au conflit entre le respect de l'autonomie et la justice. Par exemple, il est possible qu'un patient âgé ayant subi un accident cérébrovasculaire souhaite demeurer à l'unité de réadaptation pour une période plus longue que celle jugée cliniquement nécessaire en raison de l'incertitude liée à l'adaptation à sa nouvelle vie avec une incapacité hors du milieu hospitalier. Mais il est possible que le nombre de lits de l'unité de réadaptation constitue une ressource limitée dont on a besoin pour les autres patients. La solution à ce problème est habituellement déterminée en faisant appel à la politique de l'établissement hospitalier ou toute politique pertinente, qui précise parfois ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas de la part des patients et des équipes cliniques touchés dans de telles situations, et en invitant toutes les parties intéressées à discuter entre elles afin d'arriver à une entente qui soit acceptable sur le plan éthique (Rudnick 2007a) et qui permettrait éventuellement de formuler ou de modifier les politiques en cause.
Il y existe également des problèmes bioéthiques concernant le conflit ente la bienfaisance et la justice. Par exemple, il est possible que le patient ayant subi un accident cérébrovasculaire, dont il a été question auparavant, soit plus à l'aise émotionnellement s'il est renvoyé à la maison aux soins de sa famille, mais il se peut que le fardeau de tels soins soit considérable pour la famille, même si des services de soutien à domicile lui sont offerts. La solution à ce problème est habituellement déterminée en faisant appel aux priorités de la famille, qui renvoie au principe du respect de l'autonomie, bien qu'il soit ici question de l'autonomie de la famille. Dans les cas où la famille n'est pas disposée à offrir les soins à domicile au patient, il n'est pas rare de s'attendre à ce qu'elle trouve une solution de placement ou, du moins, qu'elle accepte les propositions de placement lorsqu'elles sont organisées (en offrant quelques possibilités au patient et à sa famille parmi une sélection de placements disponibles en mesure de lui offrir des soins adéquats).
D'autres problèmes bioéthiques ont pour objet le conflit entre le respect de l'autonomie et la bienfaisance ou la non malfaisance. Par exemple, il est possible qu'un patient atteint de schizophrénie désire vivre de façon autonome, mais qu'il ne dispose pas suffisamment d'aptitudes à la vie quotidienne pour le réaliser de façon sécuritaire et qu'il ou elle ne soit pas suffisamment conscient(e) des risques que cela implique. Cette situation soulève la question de l'empêchement en réadaptation psychiatrique, c'est-à-dire, dans le cas présent, l'empêchement relatif à la réadaptation en résidence. Alors que l'empêchement dans le domaine de la réadaptation psychiatrique est parfois possible et acceptable, comme lorsque, sans traitement approprié, le patient pose un danger pour lui-même et pour les autres en raison des hallucinations auditives irrésistibles et pressantes lui ordonnant de se blesser ou de se suicider, ou de blesser et de tuer quelqu'un, il peut également être impossible ou moins acceptable. Il en va ainsi parce que la réadaptation nécessite la coopération du patient, et parce qu'elle exige également que l'on mette l'accent sur la réalisation des objectifs de vie du patient, comme ses objectifs en matière de domicile, afin que l'empêchement modifiant ces objectifs soit considéré comme étant particulièrement perturbant, plus encore que le traitement obligatoire qui vise la modification (le soulagement) des symptômes (Rudnick 2007b). La solution à ce problème requiert parfois un empêchement temporaire pour éviter un grave danger, comme l'hospitalisation forcée (ou placement involontaire) (Rudnick 2002b), tout en cherchant des objectifs plus réalistes avec le patient, comme le soutien à domicile mentionné dans le cas précédent, et en espérant, si possible, la réalisation des objectifs initiaux du patient à long terme.
Finalement, certains problèmes bioéthiques en réadaptation sont liés au conflit au sein des considérations liées à la justice. Par exemple, le fait de décider de la manière dont les ressources sont affectées pour la réadaptation, par rapport aux autres objectifs de soins de santé, soit le traitement et la prévention (primaire), et de la manière d'affecter les ressources dans divers domaines de la réadaptation, soit la réadaptation à la suite d'une amputation, d'un accident cérébrovasculaire, d'un arrêt cardiaque, d'une blessure médullaire ou en lien avec la cécité acquise, etc., exige un processus raisonné. Il existe plus d'une façon raisonnable de déterminer ce qui est juste, par exemple en se basant sur la gravité du problème de santé (c'est-à-dire que plus une population a de graves problèmes de santé, plus elle mérite de ressources) en comparaison aux chances de réussite (sur le plan des soins de santé) – qui peuvent elles-mêmes faire l'objet d'une disparité dans les critères (c'est-à-dire que plus grandes sont les chances d'obtenir une telle réussite, plus la population en cause mérite les ressources). Il y a différentes valeurs qui sous-tendent ces diverses façons de déterminer ce qui est juste, par exemple, le besoin dépend de la gravité du problème de santé, évoquant donc une théorie de la justice liée au bien-être, alors que le résultat dépend de la réussite, évoquant une théorie utilitariste de la justice (en admettant que ces approches ne sont pas mutuellement exclusives ou exhaustives). La solution à ce problème et aux autres problèmes liés à l'affectation des ressources relatives à la réadaptation peut nécessiter la formulation de politiques qui soit fortement nourrie du débat public officiel, instituant ainsi l'éthique dans l'arène politique au sens large (Rudnick 2002a).
Conclusion
L'éthique en réadaptation traite d'une variété de questions pouvant être formulées comme des problèmes bioéthiques de conflits de valeurs en matière de respect de l'autonomie, de bienfaisance, de non malfaisance et de justice. Le dialogue et les politiques nourries par le débat public sont nécessaires dans la détermination de solutions raisonnées qui soient acceptables pour tous les intervenants et toutes les parties concernées.
Réhabilitation -