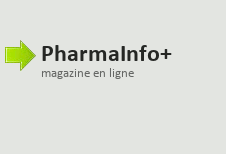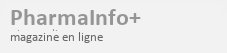La dystrophie myotonique de Steinert
Qu'est-ce que la dystrophie myotonique de Steinert ?
La dystrophie myotonique de Steinert est une maladie génétique autosomique dominante associant une dystrophie musculaire, une myotonie et des anomalies multisystémiques. C'est la plus fréquente des maladies neuromusculaires de l'adulte. Sa prévalence est d'environ 5 cas pour 100 000 habitants.
Comment se manifeste-t-elle ?
On décrit deux grandes entités cliniques distinctes, qui correspondent pourtant à des anomalies du même gène.
La forme adulte commune, qui associe :
- une dystrophie (faiblesse et atrophie) musculaire progressive;
- une myotonie : lenteur anormale de la décontraction musculaire (par exemple la main qui reste crispée après une poignée de main);
- des anomalies d'autres organes : œil (cataracte chez presque tous les patients après 40 ans), système nerveux (troubles du sommeil, troubles des fonctions cognitives, troubles de l'humeur), cœur (troubles du rythme et/ou de la conduction parfois responsables de mort subite), appareil respiratoire (pneumopathies), appareil digestif, glandes endocrines.
La gravité de la maladie dépend de l'âge de début, des signes cliniques, de l'évolution.
La forme congénitale associe un tableau d'hypotonie néonatale et de détresse respiratoire aigüe gravissime. L'évolution, si l'enfant survit, est invalidante, surtout sur le plan intellectuel. Sa transmission exclusivement maternelle n'est pas clairement expliquée.
Quelle en est la cause ?
La maladie de Steinert est une maladie génétique à transmission autosomique dominante : il y a un risque sur deux que le parent atteint transmette la maladie à chacun de ses enfants). Le gène de cette maladie est maintenant localisé précisément (sur le chromosome 19) et identifié. Il code une protéine, la myotonine-kinase, dont la fonction reste mal connue. L'anomalie génétique, d'un type particulier, explique sans doute le phénomène d'anticipation (la maladie semble de plus en plus grave au fur et à mesure des générations).
Comment évolue-t-elle ?
L'âge moyen de début se situe autour de 20 à 25 ans, mais tous les âges de début peuvent s'observer. Cependant le caractère insidieux des troubles rend le diagnostic habituellement tardif.
L'évolution de cette maladie est variable : parfois bien tolérée et compatible avec une activité socioprofessionnelle, parfois responsable d'une impotence grave (perte de la marche après 15 à 20 ans d'évolution, avec un certain degré d'atteinte intellectuelle). Il semble cependant que l'évolution soit d'autant plus invalidante que la maladie commence tôt.
La progression de la maladie est lente et se fait à vitesse constante chez un même sujet. Au sein d'une même famille, une forme mineure n'exclut pas la survenue d'une forme congénitale (plus précoce et plus sévère). Cependant, la maladie a une tendance nette à s'aggraver et à débuter de plus en plus tôt au fur et à mesure des générations : c'est le phénomène d'anticipation.
Quels traitements et prise en charge peut-on proposer ?
Il n'existe pas actuellement de traitement curatif de la maladie. Sa prise en charge consiste en divers moyens médicamenteux et/ou techniques visant à améliorer la qualité de vie du sujet. La surveillance cardiaque est particulièrement nécessaire afin de prévenir ces complications par la pose d'un pacemaker. La myotonie, les douleurs, les troubles de l'humeur peuvent bénéficier de traitements médicamenteux efficaces. La kinésithérapie est un élément de confort très apprécié par ces patients. Certaines précautions médicamenteuses sont à observer et des précautions anesthésiques sont indispensables lorsqu'une intervention chirurgicale doit être entreprise, ce d'autant que l'intervention est banale et la maladie souvent méconnue (les interventions les plus fréquentes chez ces patients sont l'intervention pour la cataracte ou l'ablation de la vésicule biliaire).
Vivre avec la maladie de Steinert
Même si la maladie est bien connue dans certaines familles, elle est parfois vécue comme une épée de Damoclès, surtout par les femmes qui connaissent le risque de transmission d'une forme néonatale. Les récentes avancées de la recherche et des techniques de génétique moléculaire permettent maintenant de proposer un conseil génétique à ces familles. Tout membre, atteint ou pas, d'une famille touchée par cette maladie peut consulter un généticien clinicien afin de préciser le diagnostic pour lui-même ou sa descendance. Dans ce cas, une étude génétique familiale peut être menée et permet, à l'occasion d'une grossesse, d'établir un diagnostic prénatal si les parents le souhaitent. Cependant, si le fœtus est atteint, il est difficile, dans l'état actuel des connaissances, de se prononcer sur la gravité potentielle de cette atteinte et de porter un pronostic. C'est pourquoi toute la démarche concernant le conseil génétique doit s'accompagner d'un soutien attentif des parents.
Réhabilitation -