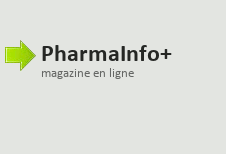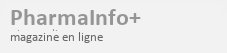Un nouveau piège à cholestérol
L’excès de cholestérol est le principal facteur de risque des maladies cardio-vasculaires dans les pays industrialisés, c’est-à-dire, indirectement, la première cause de mortalité.
Contrairement au « bon » cholestérol, le « mauvais » circule dans le sang sous forme de particules lipidiques qui se déposent sur les parois des artères. En s’accumulant, ces dépôts forment des plaques dites d’athérome qui réduisent le diamètre interne des vaisseaux. Elles risquent de croître jusqu’à obstruer l’artère, ou bien d’être arrachées, déclenchant ainsi la formation d’un caillot qui, en bloquant la circulation sanguine, cause un infarctus. Pour limiter ces risques, on doit réduire la concentration sanguine en « mauvais » cholestérol, le cholestérol dit LDL, sans altérer la concentration du « bon », le cholestérol dit HDL. Thierry GrandPerret, Marc Issandou et leur équipe des Laboratoires GlaxoSmithKline, aux Ulis, ont découvert des molécules qui abaissent la concentration sanguine en « mauvais » cholestérol chez les hamsters : elles stimulent la synthèse du récepteur de ce cholestérol exprimé notamment par les cellules du foie, principal organe responsable de l’élimination du « mauvais » cholestérol. La fixation des particules lipidiques de ce cholestérol sur ces « pièges » semble en accélérer la dégradation.
Le récepteur du cholestérol LDLest la pièce centrale du contrôle de la concentration sanguine en cholestérol. Cette protéine capte le cholestérol, le fait pénétrer dans les cellules hépatiques et le conduit dans des poches nommées lysosomes, où il est digéré, puis recyclé. En moins de dix minutes, un récepteur peut prendre en charge et détruire des centaines de molécules de cholestérol. Ainsi, chez les lapins modifiés génétiquement qui n’expriment plus ce récepteur, la concentration en cholestérol dans le sang est 20 fois supérieure à la normale.
Les molécules synthétiques mises au point par T. GrandPerret et ses collègues stimulent la synthèse du récepteur du cholestérol en agissant directement sur le gène qui code cette protéine. Pour ce faire, ils augmentent la concentration d’une protéine se fixant sur la portion d’ADN qui commande l’expression du gène codant ce récepteur. Quand on augmente la concentration du signal déclenchant l’expression du gène, la concentration de la protéine qu’il code augmente. Pourquoi les protéines qui se fixent sur la séquence régulatrice, nommée SREBP, n’agissent-elles pas spontanément quand la concentration en cholestérol devient trop élevée ? Parce qu’elles sont piégées au sein d’un organite cellulaire, le réticulum endoplasmique, par une autre protéine nommée SCAP.
La nouvelle classe de molécules libère précisément SRFBP de l’entrave qui la retient prisonnière. Ces nouvelles molécules, nommées GW, se fixent sur la protéine SCAP et conduisent le complexe SREBP-SCAP dans l’appareil de Golgi, un autre constituant cellulaire, où les deux molécules sont séparées. Libérée, SREBP pénètre dans le noyau et se fixe sur la séquence qui active l’expression du gène codant pour le récepteur du cholestérol LDL. Le composé le plus performant de la famille GW est le GW 532 ; administré à des hamsters pendant trois jours, il abaisse la concentration sanguine en cholestérol LDL de 80 pour cent. Par comparaison, les statines, les médicaments les plus efficaces dont on dispose aujourd’hui pour traiter l’excès de cholestérol, ne produisent aucun effet notable sur ces animaux. Les statines inhibent la synthèse du cholestérol par le foie. Elles agissent donc indirectement sur le complexe SRESP-SCAP, car en diminuant la concentration en cholestérol intracellulaire, elles favorisent la libération de SREBP.
La nouvelle classe de molécules agit directement sur le complexe SREBP-SCAP indépendamment de la teneur cellulaire en cholestérol, ce qui permet d’envisager des effets bénéfiques plus importants. De la découverte en laboratoire à un éventuel médicament commercialisé, s’écoule généralement une dizaine d’années, mais on peut espérer disposer un jour d’une famille de substances normalisant la concentration sanguine en cholestérol LDL fondée sur un principe nouveau. D’ores et déjà, la prévention reste le meilleur des alliés puisque divers facteurs de risque ont été identifiés : la cigarette, une alimentation mal équilibrée ou encore le manque d’exercice physique.
Découverte -