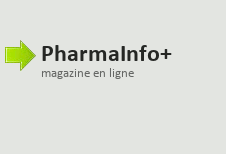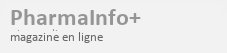Polluants, Mensonges
et... Stérilité !
Les crises successives de « la vache folle », et du « poulet à la dioxine » ont déjà ébranlé la confiance du consommateur, et nous avons vu fleurir des labels de qualité pour réconforter les plus inquiets. La recherche scientifique a tenté depuis de nombreuses années d’élucider les problèmes de toxicité des dioxines, éthers de glycol et pesticides. Des expertises réalisées par l’INSERM, à la demande de l’État, ont tenté de statuer sur les risques des dioxines et éthers de glycol. Deux rapports édités par l’INSERM ont permis de cerner ces problèmes. Malheureusement, les résultats parfois conflictuels de plusieurs laboratoires de recherches européens et étrangers, publics et privés, n’ont pas encore donné des résultats tangibles sur la toxicité des dioxines, des éthers de glycol et des pesticides. Nous tenterons dans cet article de débroussailler ce terrain de recherche et d’essayer de tirer des conclusions sur la conduite à tenir vis-à-vis de ces produits.
La toxicité de trois types de molécules sera analysée dans cet article : les xénohormones ou les perturbateurs endocriniens comme certains pesticides, colorants, ou plastifiants ; les dioxines qui sont des molécules libérées par les incinérateurs industriels ; et enfin les éthers de glycol qui sont des solvants couramment utilisés dans les peintures, les cosmétiques, la sidérurgie, les savons...
Pollution et appareil reproducteur
À noter : l’incidence des polluants et des produits chimiques sur la fertilité et l’augmentation des cancers mammaires et testiculaires.
Un certain nombre d’études a mis en évidence plusieurs indices suggérant une altération dans les fonctions de reproduction masculine au cours des cinquante dernières années, en particulier une diminution de la qualité spermatique, une augmentation des malformations de l’appareil de reproduction ainsi qu’une augmentation de la fréquence des cancers du testicule. Ces anomalies ont été décelées dans un premier temps dans le règne animal, chez les oiseaux, les alligators, les chiens et les poissons, faisant ainsi suspecter des modifications de l’environnement. Parmi les substances incriminées, nous trouvons les pesticides largement utilisés depuis les années 40, ainsi que les plastifiants.
Les altérations des fonctions de la reproduction ne se sont pas limitées au monde animal ; en 1974, un article de Nelson et al. a évoqué une diminution de la qualité du sperme chez l’homme. Le problème fut relancé en 1992 après la publication d’une étude de Carlsen et al. évoquant une diminution de 50 % du nombre de spermatozoïdes par millilitre ainsi qu’une altération de la qualité des spermatozoïdes. Malgré les biais qui ont accompagné ce travail (distribution des données non homogène dans le temps et géographiquement, méthodes d’analyse du sperme différentes entre les laboratoires...), l’étude a remis en cause le problème de l’altération spermatique avec plus d’acuité.
Les données de cette étude ont été reprises par d’autres épidémiologistes qui ont confirmé cette altération.
Depuis, des études, menées en France et à l’étranger, ont été initiées dans le but de détecter une altération éventuelle de la qualité du sperme.
Une étude réalisée dans la région parisienne a confirmé cette altération, autant qualitative que quantitative, du sperme des Parisiens : déclin de 2 % par an du nombre de spermatozoïdes par millilitre ainsi qu’une augmentation du nombre de spermatozoïdes de morphologie anormale.
Cependant, les études similaires réalisées à Toulouse et en Finlande n’ont pas abouti aux mêmes conclusions de déclin de la qualité du sperme.
Les malformations de l’appareil génital mâle ont vu leur fréquence augmenter ces dernières décennies. Une augmentation des cas de cryptorchidie (syndrome caractérisé par des testicules mal descendus) a été décelée. De même, une augmentation des cas d’hypospadia (urètre mal formé) a été signalée en Angleterre, Pays de Galles, Hongrie, Suède, Norvège et Danemark tandis que la Finlande est épargnée. Enfin, on note une augmentation de l’incidence des cancers du testicule de 2 % à 4 % selon les pays.
Des études sur des modèles animaux ont renforcé ces constatations. Les animaux exposés aux organochlorés, certains éthers de glycols et pesticides souffrent de problèmes de fertilité, d’apparition de cancers testiculaires et de malformations diverses (appareil urogénital, système nerveux...)
Pourquoi l’environnement est-il incriminé ?
Les facteurs génétiques ne sont probablement pas responsables de ces altérations, d’une part parce que les phénomènes observés ont rapidement évolué (1 à 2 % par an) et, d’autre part, parce que la baisse du nombre de spermatozoïdes ainsi que l’augmentation de l’incidence des malformations sont survenues dans des zones géographiques distinctes.
Les facteurs environnementaux semblent donc être plus plausibles, en particulier parce que le testicule est l’un des organes les plus vulnérables aux rayonnements, à la chaleur et aux xénobiotiques. En outre, l’altération spermatique n’est pas généralisée à l’ensemble des pays du monde, mais localisée au niveau de certains pays ou agglomérations. Ces arguments favorisent donc l’hypothèse de l’existence, dans l’environnement, de molécules chimiques ayant une activité anti-hormonale ou mimant l’effet hormonal pouvant perturber le cycle biologique.
Les xénohormones
Les xénohormones sont des molécules chimiques qui peuvent moduler la synthèse ou la dégradation des hormones naturelles, mimer ou antagoniser les effets des hormones et/ou modifier le taux d’expression des récepteurs hormonaux.
Les xénohormones les plus connues et étudiées sont le DiÉthylStylbestrol (DES) utilisé pour prévenir les avortements spontanés, ainsi que le DichloroDiphénylTrichloroéthane (DDT), un pesticide très utilisé dans les années 60. Ces composés exercent leurs effets néfastes sur la reproduction par le biais de divers mécanismes qui convergeront vers une diminution de la fertilité et la promotion de cancers testiculaires et mammaires.
- Ces composés miment les oestrogènes et rétro-inhibent ainsi l’axe hypothalamohypophysaire, en agissant a niveau de la FSH (hormone folliculo-stimulante).
- Ils ont un effet anti-androgénique.
- Ils inhibent certaines enzymes de la synthèse de la testostérone.
- Ils augmentent l’élimination de la testostérone.
Modulation illégitime du récepteur aux oestrogènes et aux androgènes
Les deux récepteurs stéroïdiens les plus touchés par les xénohormones sont le récepteur aux oestrogènes (RE) et le récepteurs aux androgènes (RA). Ils appartiennent à la famille des récepteurs nucléaires. Quand l’hormone interagit avec son récepteur spécifique, ce dernier change de conformation, se libère des protéines chaperonnes, puis se dimérise (figure 1). Le complexe hormone-récepteur dimérique est ensuite transloqué vers le noyau où il se lie à une séquence spécifique appelée ERE (élément de réponse à l’oestradiol) localisée dans un promoteur cible. Les pesticides organochlorés (Endosulfan, Toxaphène, o,p’DDT, Dieldrine...) interagissent directement avec le RE, ces molécules déplacent le 17-8 oestradiol de son récepteur. Le complexe pesticide/RE peut donc transactiver des promoteurs contenant des EREs, et donc activer de façon illégitime des gènes sensibles à l’oestradiol. Les lignées de tumeurs mammaires MCF-7 et T47D, sensibles à l’oestradiol, se multiplient en présence de ces pesticides. Ceci pourrait avoir une incidence importante sur les cancers mammaires et utérins qui sont en partie hormono-dépendants.
Cependant, une étude menée par Hunter et al. n’a pas montré de corrélation entre une exposition prolongée au DDT et une augmentation de l’incidence des cancers du sein.
Cette étude est controversée car d’autres auteurs ont suggéré que les composés organochlorés peuvent être présents à faibles doses dans le sang, mais 250 à 1 000 fois plus concentrés au niveau du tissu adipeux formant en partie le sein.
Ces composés peuvent être relargués du tissu adipeux causant ainsi de fortes concentrations locales qui entraînent une activité biologique importante. D’autre part, le régime alimentaire peut influer sur le risque de cancer du sein causé par les pesticides. L’ingestion d’aliments contenant des isoflavonoïdes (graines de soja) ou la curcumine (épices) a un effet inhibiteur sur l’activité oestrogénique des pesticides. Ainsi, des femmes exposées à de fortes doses de DDT peuvent avoir des risques différents de cancers du sein suivant leurs habitudes alimentaires.
Cette activation illégitime du RE peut entraîner plusieurs perturbations notoires comme l’inhibition des hormones FSH et LH (hormone lutéinisante) par rétrocontrôle négatif. Deux axes seront ainsi perturbés : l’axe LH/cellules de Leydig et l’axe FSH/cellules de Sertoli.
L’inhibition de la sécrétion de LH induirait une inhibition de la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig. Cette perturbation dans la production de testostérone peut créer une altération du compte spermatique chez l’homme adulte semblable à celle observée chez les agriculteurs de bananiers dans certains pays tropicaux utilisant comme pesticide le o,p’DDT.
De plus, l’inhibition de la FSH pourrait induire une mauvaise prolifération des cellules de Sertoli. Ceci engendrerait, à l’age adulte, une oligozoospermie ou une azoospermie irréversibles.
Les xénohormones peuvent provoquer aussi des malformations comme la persistance du canal de Müller chez le mâle. L’hormone antimüllerienne (AMH), sécrétée par les cellules de Sertoli, est responsable de la régression des canaux de Müller. L’analyse des embryons de souris exposés au Diéthylstilbestrol (DES) a révélé une régression incomplète ou retardée des canaux de Müller chez la progéniture mâle. In vitro, des expériences de cultures d’organes ont montré l’effet inhibiteur du DES sur la régression des canaux de Müller. Une exposition prolongée à des composés mimant l’effet de l’oestradiol, lors de la grossesse, pourrait expliquer les anomalies structurales dues à la mauvaise régression des canaux de Müller après la naissance. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les androgènes, dont la testostérone, exercent un rôle important dans l’établissement des caractères sexuels primaires ou secondaires. Certains composés comme le o,p’DDT, son métabolite le p,p’DDE ou la vinclozoline ont un effet antiandrogénique. Ils se lient au RA et bloquent sa fonction. L’exposition à ces composés durant la puberté ou l’age adulte pourrait entraîner des perturbations dans l’apparition des caractères sexuels masculins.
Pourquoi ces molécules sont-elles plus dangereuses que les hormones correspondantes ?
L’exposition aux xénohormones pendant des périodes du développement où les hormones ne sont pas sécrétées peut être délétère et provoquer des malformations. De même, l’inhibition de l’effet hormonal pendant le développement peut retarder l’apparition des caractères sexuels masculins ou féminins.
L’oestradiol ainsi que la testostérone sont des composés hydrophobes. Pour être transportés dans le sang, ils sont liés à des protéines plasmatiques comme l’albumine ou plus spécifiquement la β-globine ; ces protéines sont appelées SSBG (Sex-Steroid Binding Globine : protéines vectrices des stéroïdes sexuels). De cette manière, ces hormones sont bloquées par les SSBG et n’agissent qu’au niveau du tissu cible.
Les composés exogènes se lient peu aux protéines vectrices, et exercent leur action xénohormonale d’une façon plus importante que les hormones naturelles. Comme nous l’avons mentionné, la testostérone et l’oestradiol sont éliminés par l’organisme grâce à plusieurs protéines P450. Les composés chimiques exogènes ont une demi-vie beaucoup plus longue que les hormones naturelles, car l’organisme possède peu d’enzymes pour les dégrader en vue de les éliminer. Ainsi, une exposition de longue durée à de faibles doses de xénohormones a un effet cumulatif.
Les dioxines
Les dioxines appartiennent à une famille de composés aromatiques polycycliques chlorés et présentant des propriétés physico-chimiques semblables. Elles ne diffèrent que par le nombre et la position des atomes de chlore, ainsi que la disposition des cycles aromatiques. Quand on parle de « la dioxine », on fait généralement allusion à la plus toxique de ces molécules, la 2,3,7,8-TétraChloroDibenzo-p-Dioxine (TCDD) qui a été relarguée durant l’accident industriel de Seveso. Une propriété importante de ce type de composés est leur grande stabilité physique et chimique due à la présence des atomes de chlore. Elles sont peu biodégradables et donc s’accumulent dans la nature, chez les végétaux et animaux, en particulier dans l’organisme humain. Elles peuvent malheureusement y subsister pendant de nombreuses années. Du fait de leur caractère lipophile, les dioxines se concentrent essentiellement dans la masse graisseuse, le long de la chaîne alimentaire, qui est avec l’inhalation, la voie principale d’exposition chez l’homme.
Toxicité de la dioxine
Chez l’homme, une exposition à court terme à des teneurs élevées en dioxine peut être à l’origine de lésions cutanées, de chloracné et de formation de taches sombres sur la peau par exemple, ainsi qu’une altération de la fonction hépatique.
Une exposition prolongée est corrélée à une atteinte du système immunitaire, à la perturbation du développement du système nerveux et à des troubles du système endocrinien et de la fonction de reproduction. L’exposition chronique d’animaux aux dioxines entraîne l’apparition de plusieurs types de cancer.
Les données expérimentales obtenues chez l’animal montrent sans équivoque que les dioxines sont des agents cancérigènes, qui, parfois à de faibles doses, provoquent des effets toxiques divers sur la reproduction, l’immunité et le système nerveux. Chez l’homme, les données épidémiologiques sont difficilement interprétables du fait notamment d’expositions complexes. Seul l’effet cancérigène de la 2,3,7,8 TCDD a été confirmé, les autres effets étant transitoires ou sujets à des interprétations peu concluantes.
Les sources d’émission sont multiples et variées.
D’après des données publiées en Europe, depuis la fin des années 70, l’amélioration des procédés industriels et l’abandon de certaines fabrications ont conduit à une diminution globale des émissions. Des seuils d’exposition ont été établis afin de minimiser le risque de contamination par les dioxines :
- Une exposition journalière inférieure à 1 pg TEQ/kg (TEQ : EQuivalent Toxique) exclut a priori tout risque pour la santé publique.
- Une exposition journalière supérieure à 10 pg TEQ/kg pendant une longue période est considérée comme pouvant entraîner des risques d’effets néfastes.
- Une exposition journalière à long terme entre 1 et 10 pg/kg ne semble pas entraîner de signes de toxicité chez l’homme mais ne donne pas une marge de sécurité suffisante pour exclure tout risque pour la population.
Il s’agit donc, d’une part de prendre des mesures visant à réduire le risque par une diminution des émissions et d’autre part, de conduire des études permettant une meilleure évaluation du risque en Europe.
Mode d’action de la dioxine
Les dioxines agissent par le biais de plusieurs mécanismes pour altérer la fertilité et promouvoir les cancers. Les dioxines se lient à un récepteur cellulaire, le AhR (Arylhydrocarbon Receptor).Celui-ci se dissocie alors de la protéine chaperonne hsp90 (heat shock protein 90 kDa). Puis il est transloqué dans le noyau. Au niveau de ce dernier, le AhR s’héterodimérise avec le facteur de transcription ARNT. Ce complexe se lie au niveau des promoteurs de leurs gènes cibles pour activer la transcription.
La dioxine se comporte comme un perturbateur endocrinien. Elle agit sur les cellules de Granulosa en inhibant la stéroïdogenèse, la prolifération cellulaire, et le transport de glucose.
La dioxine peut aussi avoir un rôle proapoptotique. Ces effets sur les cellules de la Granulosa altèrent la production de la progestérone et ainsi l’axe LH/FSH. Des concentrations importantes de LH et de FSH sont décelées dans le sang de sujets exposés à la dioxine. La dioxine exerce aussi des effets anti-androgénique et anti-oestrogénique. Ceci induit une diminution du poids des testicules, de l’épididyme et de la prostate. En conclusion, la dioxine agit par plusieurs biais pour altérer la fertilité ou promouvoir des cancers.
Les éthers de glycol
Les éthers de glycol sont des solvants organiques incolores et miscibles dans l’eau et d’autres solvants organiques. Les éthers de glycol sont divisés en deux familles : les éthylènes glycol et les propylènes glycol. Ces produits sont très facilement absorbés par inhalation et traversent aisément la barrière cutanée. Certains éthers de glycol, comme le 2-méthoxyéthanol (MG), traversent rapidement la barrière placentaire, ce qui les rend toxiques pour le foetus. Chez le rongeur, le MG est retrouvé dans le compartiment foetal cinq minutes après le traitement de la mère. De même, certains éthers de glycol ainsi que leur métabolites se retrouvent dans les tractus génitaux mâles après une exposition. Ainsi les propriétés d’absorption, métaboliques, et cinétiques contribuent à la toxicité de certains éthers de glycol.
Plusieurs produits (peintures, lave vitres, médicaments...) contenant des éthers de glycol du groupe 1, le plus toxique, ont été retirés du marché en 1996. André Cicolella de l’INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des RISques) note néanmoins que 530 000 hommes et 340 000 femmes ont été exposés à ces produits avant leur retrait. Un des exemples souvent cité d’exposition aux éthers de glycol est celui du peintre étalant une peinture contenant 0,9 % de méthyl-glycol (ce qui était le cas de la peinture retirée du marché) sur une surface de 16 m2. La dose absorbée lors de la pose peut être estimée à 6,7 mg/kg, pour un individu d’un poids moyen de 70 kg. La dose limite de référence est de 0,03 mg/kg à 2,7 mg/kg selon les produits.
Ethers de glycol et spermatogenèse
Plusieurs études sur les animaux ont montré que les spermatocytes primaires sont des cibles des éthers de glycol durant le stade pachytène de leur division. Les spermatogonies sont affectées par les éthers de glycol mais à des concentrations plus élevées.
Une étude épidémiologique a été réalisée sur 73 peintres de bateaux exposés aux éthers de glycol comparés à 40 hommes non exposés. Cette étude a montré un pourcentage plus important d’azoospermie et d’oligospermie chez les hommes exposés. Une autre étude réalisée sur des femmes exposées à l’éthylène glycol travaillant dans la manufacture de semiconducteurs durant la période 1980-1989, montre une augmentation du risque d’avortement spontané et une diminution de leur fertilité. Des anomalies de la durée ou de la régularité des cycles menstruels ainsi qu’une diminution de la fertilité (taux de fécondabilité abaissé ou difficulté à concevoir un enfant) ont été rapportées chez des femmes travaillant dans les secteurs les plus exposés aux éthers de glycol.
Le mode d’action moléculaire des éthers de glycol est encore mal connu. Peu d’études ont été consacrées pour identifier les gènes régulés par les éthers de glycol. Une étude par PCR soustractive réalisée sur des testicules de rats traités par l’EGME a montré une régulation de quelques gènes (kinase, enzyme antioxydant...).
À la différence des xénohormones et des dioxines, on ne connaît pas de cible moléculaire des éthers de glycol. Cette mauvaise compréhension de leur mode d’action retarde le développement de traitements pour les personnes qui ont été intoxiquées par ces molécules.
L’évaluation des potentialités mutagènes et Réno-toxiques des éthers a été décelée grâce aux modèles cellulaires in vitro et in vivo. Voici un bref rappel des principaux éthers de glycol testés :
- Le métabolite aldéhydique de l’EGME (Ethylene Glycol Methyl Ether), et de l’EGBE (Ethylene Glycol n-Butyl Ether) provoquent une mutagénicité sur les bactéries et les cellules de mammifères.
- Les métabolites aldéhydiques (MALD, EALD, BALD) à faible concentration (0,1 à 1 mM) provoquent des aberrations chromosomiques sur les cellules de mammifères (clastogénicité).
- L’EGME, l’EGEE (Ethylene Glycol Ethyl Ether), et l’EGBE induisent in vitro la formation de micronoyaux et d’aneuploïdie. Ces mêmes molécules induisent aussi des échanges entre chromatides soeurs.
Outre leur génotoxicité et leurs effets sur la fertilité, certains éthers de glycol peuvent avoir une toxicité hématologique. Quelques cas d’hémolyse aiguë, toujours modérée, faisant suite à l’ingestion de plusieurs dizaines de millilitres d’EGBE sont publiés. Les travaux menés in vitro confirment la faible sensibilité des hématies humaines aux éthers de glycol, en particulier l’EGBE, qui est le plus hémolysant chez les animaux. En effet, de très fortes doses d’EGBE sont nécessaires pour observer des anomalies des hématies humaines.
Chez les salariés exposés aux éthers de glycol, un nombre relativement élevé de travaux ont rapporté des cytopénies sanguines a priori d’origine centrale, médullaire. Même si une coexposition à d’autres solvants ne peut être exclue, il n’en demeure pas moins que l’accumulation des cas suggère une toxicité possible des éthers de glycol sur les lignées sanguines, en particulier sur la lignée polynucléaire neutrophile. Neutropénie et hypoplasie médullaire ont été observées après des expositions associant ou non des solvants différents à l’EGME, l’EGEE et leurs acétates. Il est donc nécessaire de s’interroger sur le fait que certains éthers de glycol pourraient être responsables chez l’homme d’une hypoplasie médullaire, touchant préférentiellement la lignée neutrophile. Deux études portant sur de petits effectifs, menées chez des peintres de chantier naval, ont mis en évidence des leucopénies et des anémies associées à l’exposition à l’EGME, l’EGEE et l’EGEEA (Ethylene Glycol Ethyl Ether Acétate).
Mieux vaut prévenir que guérir
Le seul moyen dont nous disposons actuellement pour pallier les effets nocifs des xénoestrogènes, est d’empêcher l’utilisation de ces produits. Plusieurs tests ont été développés afin de détecter les effets oestrogénomimétiques de certains composés ; nous en détaillerons quelques-uns.
Tests in vivo
Taille de l’utérus : La taille de l’utérus des rongeurs est sensible à l’oestradiol. Le produit à tester est injecté à des rates, l’utérus est ensuite prélevé et pesé. Ce test présente plusieurs désavantages, dont le coût et la toxicité éventuelle du produit.
Synthèse de la vitellogénine : Le gène de la vitellogénine chez la truite est régulé par l’oestradiol. Son promoteur contient plusieurs ERES. Des truites mâles sont placées dans un milieu contenant le produit à tester. Le taux de vitellogénine est ensuite dosé afin de déceler la présence d’un composé mimant l’effet de l’oestradiol.
Le sexe des tortues : Le sexe des tortues est déterminé par la température ; les oeufs incubés à une température de 26°C donneront des mâles ; alors que les oeufs incubées à 31°C généreront des femelles. Cependant le déterminisme du sexe des tortues peut être réversé suite à l’addition d’oestradiol. Ainsi les oeufs de tortue placés à 26°C sont badigeonnés de produit à tester, le sexe à la naissance permettra de déterminer si cette molécule a un effet xénohormonal.
Tests in vitro
Vu les difficultés, le coût élevé et le caractère peu quantitatif des tests réalisés in vivo, une série de tests in vitro a été développée.
Le test de liaison : ce test permet de déterminer si un produit est capable de se lier au RE. Pour cela la molécule est incubée avec du RE lié à l’oestradiol radiomarqué ; le déplacement de l’oestradiol par 1a molécule testée permet d’évaluer l’affinité de cette molécule pour le RE.
La croissance des cellules MCF-7 ou T47D : comme nous l’avons mentionné précédemment, la croissance des cellules MCF-7 et T47D est stimulée par l’oestradiol. Ces cellules sont incubées en présence du produit à tester. Leur croissance permettra de déterminer si la molécule testée mime l’effet de l’oestradiol.
Les souches de levures recombinantes : le vecteur d’expression du RE ainsi qu’un gène rapporteur contenant dans son promoteur un élément de réponse à l’oestradiol (ERE) sont introduits dans les levures. Ces levures sont incubées en présence de la molécule à tester. Si cette dernière mime l’effet de l’oestradiol, elle activera le gène rapporteur. Ce test est très sensible.
Transfection de cellules humaines : Les cellules humaines transfectées par un plasmide répondant à l’oestradiol pourraient être un bon moyen pour détecter l’effet oestrogènomimétique de certains composés. Dans ce but, nous avons développé une séquence ERE hypersensible à l’oestradiol. Cette séquence, appelée overERE, est formée de deux ERE chevauchants ; elle lie d’une manière coopérative deux dimères de RE de part et d’autre de la double hélice de l’ADN. Ces deux séquences chevauchantes ont un effet synergique sur la transcription, c’est donc un bon moyen de détecter de nouvelles molécules mimant l’effet de l’oestradiol. Grâce à la séquence overERE, l’activité oestrogéno-mimétique de certains composés a été détectée à une concentration 100 fois plus faible qu’avec le ERE classique. Ces résultats montrent une augmentation importante de la sensibilité de détection des xénoestrogènes grâce à l’agencement de manière chevauchante des ERE.
Environnement -