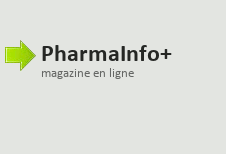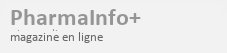Les medicaments « chiraux »
Chaque année, 70 % des nouvelles autorisations de mise sur le marché portent sur des concoctions chirales. « Il est probable que 80 % des nouvelles molécules en cours de développement sont de nature chirale », avance Ron Carroll, vice-président de la technologie chez Cambrex, une entreprise de chimie de spécialités qui va débourser 15 millions de dollars pour acquérir la division d’intermédiaires chiraux de Celgene.
Mais pourquoi cet intérêt pour les composés chiraux, ces molécules de même formule chimique mais dont les struc-tures géométriques sont des images inversées l’une de l’autre par rapport à un plan assimilé à un miroir ? Réponse : cette petite différence peut avoir des effets biochimiques radicalement différents.
Dans l’interaction d’un médicament au niveau d’un récepteur cellulaire ou d’une enzyme, la géométrie de la molécule chimique est souvent critique. Quand un même composé a deux formes chirales, ou « énantiomères », l’une peut agir avec la cible ; l’autre, non. Plus grave : l’une peut avoir un effet positif ; l’autre, néfaste. Ainsi, dans un mélange racamique, c’est-à-dire contenant( les deux formes, la moitié du médicament risque d’être simplement inactive. Et, dans le pire des cas, les effets secondaires de l’un des stéréoisomères rendent inutilisables les vertus de son « reflet ». D’où l’intérêt d’évaluer chacun des deux isomères séparément, tant du point de vue de l’efficacité que de la toxicité.
Symetriques, mais pas identiquesLa chimie chirale exploite un phénomène naturel. Deux molécules qui sont un reflet parfait l’une de l’autre ont souvent des propriétés très différentes. Ainsi, selon son orientation, la molécule de carvone donne son odeur de cumin des prés (s-carvone) ou de menthe verte (rcarvone). Ces deux molécules simples sont utiles. Malheureusement, dans d’autres cas, la différence entre les énantiomères peut rendre l’un utile et l’autre toxique pour des applications thérapeutiques.
Une seconde chance pour certains médicaments
Le dilemme est familier, au moins depuis la fin des années 50, avec le drame de la thalidomide. Développé comme un sédatif, le composé possède deux énantiomères, dont l’un a probablement une activité tératogène. Responsable de terribles malformations fœtales, la thalidomide avait disparu du marché, mais, grâce à une meilleure compréhension de la chimie chirale, elle est aujourd’hui de retour. Certes, il n’est plus question de la prescrire comme un simple sédatif. Mais, depuis septembre 1997, la FDA en a approuvé 1997, la FDA en a approuvé l’utilisation pour le traitement de certaines complications de la lèpre, et Celgene, qui la commercialise sous la marque Synovir, est en cours d’essais cliniques pour son application à deux maladies autoimmunitaires.
Pourtant, le Synovir reste une forme racémique, et le danger potentiel de l’un des isomères existe toujours. La différence, c’est qu’on le maîtrise mieux. Mais la chiralité pourrait donner une seconde chance à certains médicaments, et d’une manière encore plus sûre. Il suffit en effet d’éliminer l’isomère posant problème.
Les autorités médicales américaines ont interdit, en 1997, l’utilisation du mélange Fen-Phen (fenfluramine + phentéramine) pour le traitement de l’obésité. La combinaison miracle entraînant le succès du médicament Redux a malheureusement de terribles effets secondaires : hypertension pulmonaire, défaillance valvulaire, neurotoxicité...
Chiralité et législationDepuis 1992, l’intérêt de la chimie chirale est aussi réglementaire que médical ou technologique. La FDA américaine comme l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments ont en effet décidé, pratiquement en même temps, de demander aux entreprises pharmaceutiques de documenter non seulement les composés qu’elles développent, mais chaque énantiomère. En d’autres termes, une étude de toxicité devient ainsi multiple, devant porter sur chaque isomère et sur la forme racémique du produit. Il est donc beaucoup plus avantageux de développer directement un monoproduit dont l’étude sera simplifiée.
La FDA permet également une étude de ce type pour un stéréoisomère dont le mélange racémique a déjà fait l’objet d’une enquête.
Rechercher les technologies les plus efficaces
la fin de la poule aux œufs d’or pour les vendeurs de Redux, comme Allscrips, Cheshire ou WyethAyerst ? Peut-être, mais le médicament pourrait être sauvé s’il était relancé en remplaçant le mélange racémique de fenfluramine par la seule dexfenfluramine. A supposer que celle-ci confirme être l’eutomère (isomère « bénéfique ») du composé.
Le domaine est en plein essor. Des entreprises comme ChiRex, Chiroscience ou Sepracor se consacrent au développement de technologies chirales, créant même de nouveaux marchés à partir de produits existants. Ainsi, la FDA examine actuellement le levalbuterol de Sepracor, une version monoisomère du principal bronchodilatateur du marché, vendue sous forme racémique par Glaxo-Wellcome et Schering-Plough. Jusqu’ici, les essais cliniques montraient que le levalbuterol monoisomérique provoque moitié moins d’effets secondaires, à efficacité comparable, que celle du mélange racémique.
La chimie chirale étant l’une des clés de la pharmacie à venir, l’industrie est désormais lancée dans une course à la technologie. Ainsi, en achetant les intermédiaires chiraux de Celgene (rebaptisés Chiragene), Cambrex a mis la main sur un « pipeline » de produits, mais sa priorité est ailleurs : « Cela fait deux ans que nous discutons avec Celgene. Nous avions besoin d’élargir notre gamme de produits pour l’industrie pharmaceutique, mais c’est surtout la technologie qui nous intéressait », explique Douglas McMillan, viceprésident de Cambrex.
Les procédés enzymatiques : plus simples et moins coûteux
La difficulté est de développer le procédé qui fera la différence. Ainsi, ChiRex espère devenir le joueur principal dans la production d’intermédiaires servant de base à des fongicides et à des médicaments antihypertension. Pour dépasser ses concurrents, dont DSM, Chemi ou Sipsy, ChiRex a acquis les droits d’un procédé de sélection développé à Harvard et permettant, au cours de la réaction, d’obtenir directement l’énantiomère souhaité en hydrolysant sélectivement son stéréoisomère. La voie traditionnelle pour produire un monoisomère est de passer par le mélange des énantiomères, puis de les séparer. La cristallisation sélective est la technique de séparation la plus courante, expose-t-on chez Boehringer-Mannheim. Mais elle est loin d’être la seule. L’entreprise, qui commercialise son savoir-faire bioenzymatique sous la marque Chirazyme, explique que l’hydrolyse stéréosélective, ou encore l’estérification d’un seul énantiomère avec une enzyme, l’hydrolase, est aujourd’hui une solution de remplacement simple et peu coûteuse.
Et le portefeuille des technologies s’élargit. La chimie combinatoire est utilisée par des entreprises comme oxford Asymmetry, pour construire un catalogue de composés chiraux, des briques permettant un développement intelligent de nouveaux produits. La chimie des acides aminés, maîtrisée par des entreprises aussi diverses qu’Ajimoto, Rexim ou Synthetec, devient également prédominante. Et le futur appartient à des technologies en évolution, comme la synthèse asymétrique directe ou la biocatalyse.
La pharmacie chirale s’apprête à franchir une nouvelle étape, favorisée par l’arrivée massive de produits chiraux de première génération. TCI (Technology catalysts International) a ainsi identifié une vingtaine de ces médicaments - qui représenteront plus de 4 milliards de francs de chiffre d’affaire en 2000 - venant d’arriver en fin de propriété industrielle ou qui y parviendront avant 2002. Et qui pourraient connaître une seconde vie sous une autre forme chirale.
Technologie -