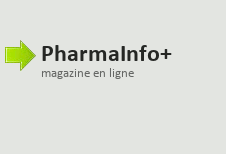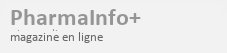Le tabagisme
au niveau européen
L’Union européenne regroupe quinze états membres avec une population totale de 376 millions d’habitants. Ses principales institutions sont le Conseil des ministres, le Parlement européen, la Commission européenne et la Cour européenne de justice. C’est à la Commission européenne qu’il appartient de proposer des mesures législatives. Il existe vingt directions générales au sein de la Commission, dont la Direction générale pour la santé et la protection du consommateur chargée tout particulièrement des programmes de santé publique (DG SANCO).
Pour que des mesures prennent force de loi, elles doivent être adoptées par le Parlement européen et par le Conseil des ministres. Les états membres ont alors l’obligation de les transposer en lois nationales.
Le cadre et les bases juridiques des décisions de l’union
Les mesures législatives proposées concernant la lutte contre le tabagisme ont été initiées dans le cadre du programme « l’Europe contre le cancer ». Créé en 1986, il a été prolongé jusqu’à fin 2002. Un nouveau programme de santé publique a été adopté en juin 2002 et prendra effet le 1er janvier 2003 pour une période de six ans. La Commission participe à la lutte contre le tabagisme à travers son programme de santé publique, en initiant, d’une part, des mesures législatives et en assurant leur mise en œuvre, et, d’autre part, en finançant des projets européens de grande envergure. Le réseau européen pour la prévention du tabagisme (ENSP) est un des projets financés dans ce cadre.
Toute directive européenne doit reposer sur une base légale établie par le Traité de l’Union. L’actuel Traité d’Amsterdam ne permet pas de légiférer dans le domaine de la santé publique. C’est pourquoi lA Commission fonde toutes les directives sur l’article 95 du Traité qui règle la libre circulation des marchandises et des services. Les directives adoptées dans le cadre de la lutte contre le tabagisme ont pour premier but d’harmoniser différentes législations nationales et de contribuer ensuite à une haute protection de santé publique. Pour illustrer ce principe, citons l’exemple de la récente directive interdisant la publicité et le parrainage pour les produits du tabac. Certains pays comme la France, la Belgique et la Finlande avaient une législation interdisant la publicité pour le tabac ; d’autres pays, comme l’Italie, avaient une interdiction partielle et enfin, il y avait des pays comme l’Allemagne, qui n’imposaient aucune restriction législative. La Commission a donc proposé une mesure pour harmoniser les approches et élever le niveau de la lutte contre le tabagisme en Europe. Depuis juillet 1989, cinq directives et une résolution ont été adoptées au niveau européen.
Les mesures prises en 1989
En juillet 1989, le Conseil des ministres a adopté une résolution demandant aux États membres de prendre des mesures pour restreindre ou interdire le tabagisme dans les lieux publics. Comparée à une directive, une résolution n’a pas de caractère obligatoire.
Elle invite les États membre à prendre des mesures volontaires au niveau national. Cette résolution prévoit que la Commission remette un rapport tous les deux ans sur les initiatives et les mesures prises. Le dernier rapport de la Commission date d’ octobre 1998 et fait état de mesures générales prises par les États. Il y a cependant peu de mesures réglant le tabagisme sur le lieu de travail et tout porte à croire que la Commission pourrait envisager de légiférer dans ce domaine. L’ENSP a d’ ailleurs préparé un rapport européen sur la situation du tabagisme sur le lieu de travail qui est actuellement sous presse. Ce rapport constituera la base d’une action de lobbying en faveur d’une réglementation au niveau européen.
En octobre 1989, Le Conseil a adopté une directive dans le cadre du règlement de la « Télévision sans frontière » interdisant, entre autres, la diffusion de publicités pour les cigarettes et les produits du tabac à la télévision.
Les avatars de la directive de 1998 sur la publicité et le parrainage
En juillet 1998, le Conseil et le Parlement européens ont adopté une directive pour une interdiction de la publicité et du parrainage. Cette directive devait entrer en vigueur le 30 juillet 2001, avec une dérogation pour les publicités dans la presse jusqu’au 30 juillet 2002 et une dérogation pour le parrainage jusqu’au 30 juillet 2003. Sous certaines conditions, le parrainage d’événements mondiaux aurait été autorisé jusqu’à octobre 2006. Ayant été obligée d’accepter la directive contre son gré (la majorité des États ont voté pour la directive à l’exception de l’Espagne, de l’Autriche et de l’Allemagne), l’Allemagne a introduit un recours en annulation auprès de la Cour européenne de justice (ECJ). En octobre 2000, la Cour a donné raison à l’Allemagne et a annulé la directive.
Actuellement, la Commission prépare une autre proposition tout à fait minimaliste, tenant compte des observations de la Cour. Cette directive ne règle que les aspects transfrontaliers de la publicité (dans la presse écrite et la radio), excluant toute mesure de limitation de la publicité indirecte.
Les organisations du lobby santé ont décidé d’agir en faveur d’une directive plus forte afin que les États membres soient explicitement autorisés à légiférer plus strictement au niveau national et à intégrer la publicité indirecte et la publicité pour le papier de cigarettes à rouler dans la proposition de directive. Un grand combat devant nous...
Les directives sur l’étiquetage et les teneurs
En novembre 1989, en mai 1990 et en mai 1992, trois autres directives avaient été adoptées légiférant en matière d’étiquetage des produits du tabac, établissant une teneur en goudron de 12 mg maximum et interdisant la vente du tabac oral (avec une exception pour la Suède). Le 16 novembre 1999, la Commission a fait une proposition de directive qui avait pour but de fondre ces trois directives en une et d’en améliorer le contenu.
Cette nouvelle directive, adoptée en juin 2001, vise à diminuer la teneur maximale en goudron de 12 à 10 mg, de limiter la teneur en nicotine à 1,0 mg et la teneur en monoxyde de carbone à 10 mg. Les États membres doivent agréer les laboratoires qui testent ces valeurs et ont la possibilité de demander l’analyse de tout autre ingrédient.
Un avertissement sanitaire doit couvrir 30 % de la face principale du paquet et 40 % de l’ autre surface au lieu de 12 % dans la directive précédente. La prescription de l’étiquetage est également plus précise et plus contraignante (noir sur blanc avec bord noir). Il est prévu la possibilité d’utiliser des images dans les avertissements, comme au Canada, dès que la Commission aura défini des règles à ce sujet.
Une grande première est l’obligation pour l’ industrie de soumettre aux autorités nationales la liste de tous les ingrédients contenus dans les produits du tabac. Jusqu’à présent, seule l’industrie savait quelles substances sont ajoutées lors de la fabrication des cigarettes. La directive prévoit également l’interdiction d’ utiliser des appellations comme « light », « ultra light », « mild » etc. qui induisent les consommateurs en erreur quant à la nocivité du tabac. Une autre mesure, particulièrement contestée par l’industrie du tabac, prévoit que les cigarettes fabriquées dans l’Union européenne doivent également correspondre aux limitations en goudron, nicotine et monoxyde de carbone. La directive a été adoptée le 5 juin 2001 après une procédure de conciliation entre le Parlement européen et le Conseil des ministres européens de la santé. Elle est entrée en application le 30 septembre 2002 avec un temps d’adaptation supplémentaire pour les taux de goudron nicotine - monoxyde de carbone qui n’entrent en application qu’en 2004 ou bien pour les mesures de restriction à l’exportation qui ne prennent effet qu’en 2007.
L’Allemagne a introduit un recours contre la directive avec un jour de retard. Ce recours n’ était pas recevable par la Cour. Cependant un autre recours a été introduit par l’industrie du tabac contre la base légale de la directive et tout particulièrement contre les mesures d’ exportation et l’interdiction des appellations trompeuses tels que « light » et « mild ».
Nous verrons quel sera le verdict... mais en septembre de cette année, l’avocat général de la Cour de justice européenne s’est prononcé en faveur de la directive. Ceci est un signe d’encouragement car, dans la plupart des cas, la Cour suit l’avis de l’avocat général.
D’autres initiatives en préparation
Entre-temps, la Commission européenne a élaboré une proposition de recommandation aux États membres, qui vise à compléter la législation déjà en place. Cette recommandation publiée en juin 2002 propose de limiter l’accès aux produits du tabac pour les jeunes en dessous de 16 ans, de réduire la promotion des produits du tabac, de contrôler les activités de promotion de l’industrie du tabac et d’améliorer la protection du non-fumeur du tabagisme passif.
Légiférer en matière de tabagisme au niveau de l’Union européenne n’ est pas facile. Le Traité de l’Union ne permet pas de prendre pour base légale la santé publique. Il faudrait donc changer ce Traité pour rendre une telle législation possible... Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) négocie une Convention cadre pour la lutte antitabac (CCLAT), premier traité international pour la santé. Cent quatrevingt-onze pays participent à cette négociation, dont l’Union européenne et ses États membres.
Le tabagisme est un problème global qui doit se régler au niveau international. Il ne s’ arrête pas aux frontières de l’Union européenne. Nos industries du tabac exportent aussi dans les pays en développement, cherchant de nouveaux consommateurs. Il est donc de notre devoir d’étendre notre action de santé publique également au-delà des frontières européennes et d’influencer les gouvernements pour une prise de position forte lors de ces négociations internationales.
Tabagisme -