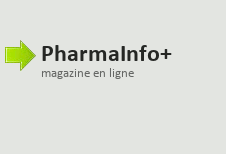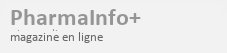I. Produits diminuant la concentration
d'ions H +
I. a. Produits neutralisants
Les groupements liant les ions H+ comme CO32- ou OH- sont partie avec leurs contre-ions de la famille des antiacides. Les réactions de neutralisation qui se produisent dans l'estomac après l'administration de CaCO, ou de NaHCO3 sont figurées dans la partie gauche. Pour les anti-acides qui ne sont pas absorbés, le contre-ion ne reste en solution qu'en milieu acide, en amont de la réaction de neutralisation. Après libération par le pancréas d'une sécrétion neutralisante, ces ions précipitent en grande partie en se combinant de nouveau à des groupements basiques, sous forme par ex de CaCO3, et sont éliminés avec les fèces. L'organisme est de ce fait à peine gêné par ces contre-ions ou les groupements basiques. En cas d'insuffisance rénale, la faible absorption suffit malgré tout pour provoquer une augmentation de la concentration sanguine du contre-ion (ex. empoisonnement par le magnésium avec des perturbations car diaques sous forme de ralentissement! Des effets secondaires sont associés à la précipitation dans l'intestin : diminution de l'absorption d'autres produits pharmaceutiques par adsorption à la surface de précipités ; perte de phosphate lors de la prise de quantités importantes d'Al(OH)
Les ions Na+ restent en solution en présence des sécrétions pancréatiques riches en HCO3- et peuvent être réabsorbés comme le HCO3-. Compte tenu de cette absorption de sodium, l'administration de NaHCO, doit être prohibée dans les maladies où l'administration de NaCl doit aussi être réduite : hypertension, insuffisance cardiaque, œdème.
Comme le bol alimentaire possède une action tampon, les anti-acides seront pris entre les repas (par ex. 1 et 3 h après les repas et pendant la nuit). Les diitiacides non absorbés seront préférés. Comme le Mg(OH)2 a un effet laxalif (à cause de son action osmotique et/ou de l'effet de Mg2+ sur la sécrétion de cholécystokinine) et que l'AI(OH), est constipant (à cause de l'effet astringent de l'Al3+), ces deux anti-acides seront le plus souvent utilisés en association.
I. b. Inhibiteurs de la production d'acide
Le neurotransmetteur acétylcholine, l'hormone gastrine et l'histamine libérée au niveau de la muqueuse stimulent les cellules pariétales de la muqueuse intestinale, et augmentent la sécrétion d'HCl. L'histamine provient des cellules entérochromaffines ; sa libération est déclenchée par le nerf vague (via des récepteurs M1) et par la gastrine. Les effets de l'acétylcholine et de l'histamine peuvent être bloqués par des antagonistes administrés par voie orale et qui parviennent à la muqueuse par la circulation sanguine.
La pirenzépine, contrairement à l'atropine, bloque préférentiellement les récepteurs de l'ACh de type M1 et provoque donc moins d'effets secondaires analogues à ceux de l'atropine.
La cellule pariétale présente cependant des récepteurs M3, si bien que le site d'action de la pirenzépine doit se situer ailleurs (cellules entérochromaffines ; transmission ganglionnaire, où les récepteurs M1 ont une action modulatrice).
Les récepteurs de l'histamine des cellules pariétales sont de type H2 et peuvent être bloqués par les antihistamiiniqes H2. A cause du rôle central de l'histamine dans la stimulation des cellules pariétales, les antihistaminiques inhibent également l'effet des autres stimuli, par ex. celui de la gastrine dans le cas de tumeurs du pancréas sécrétant de la gastrine (syndrome de Zollinger-Ellison). Le premier des antihistaminiques H2, la cimétidine, ne provoque déjà que des effets secondaires assez rares, entre autres des altérations du SNC (par ex. confusion), ou des troubles endocriniens chez l'homme (gynécomastie, diminution de la libido, impuissance). La cimétidine peut aussi bloquer dans le foie la dégradation d'autres substances. Les substances apparues plus tard, la ranitidine et la famotidme sont actives à doses plus faibles. L'inhibition des enzymes microsomiales du foie diminue de façon sensible pour des « charges en substances » plus faibles, de sorte que ces produits ne perturbent pas les traitements par d'autres médicaments.
L'oméprazole peut entraîner une inhibition maximale de la sécrétion d'acide. Après administration orale dans des dragées résistantes au suc gastrique, il parvient via la circulation sanguine jusqu'aux cellules pariétales. Il se forme alors en milieu acide un métabolite actif qui inhibe, grâce à la formation d'une liaison covalente, la pompe qui transporte dans le suc gastrique H+ en échange de K+ (H+/K+ ATPase). Le lansoprazole et le pantoprawle agissent de la même manière.