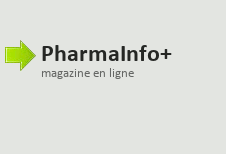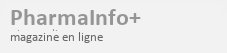Faut-il avoir
peur
d’Internet ?
Aujourd’hui, l’Internet est un moyen de communication au même titre que le courrier postal, le livre ou le journal, le téléphone et la télévision le sont depuis au moins 50 ans. Pourtant, de sa naissance dans les années 1970 aux années 1990, il n’était utilisé que dans le monde académique, puis professionnel pour rendre des services de courrier électronique et de transfert de fichiers. Puis l’application Web (un outil qui facilite la navigation) a conduit au déploiement de l’Internet dans le grand public. Plus qu’un moyen de communication, l’Internet est une infrastructure qui peut recevoir diverses formes de communication : courriers électroniques, mais aussi plus récemment, peer-to-peer, blogs... l’imagination semble sans limites, l’infrastructure pouvant a priori supporter toute nouvelle forme de communication.
Cependant, des voix s’élèvent pour prédire le pire, pour contester le caractère universel de l’infrastructure, pour remettre en cause les espoirs que l’on peut fonder dans l’usage généralisé de la communication via l’ Internet. Parmi les sujets de débat les plus fréquents figure la question de la « gouvernance de l’Internet ».
L’Internet est né, aux États-Unis, au début des années 1970, quand les progrès techniques ont autorisé la construction de réseaux d’ordinateurs grâce auxquels un usager pouvait, de sa machine, bénéficier des ressources disponibles sur des ordinateurs distants. À l’époque, les réseaux de télécommunications étaient essentiellement utilisés - et donc conçus - pour la communication téléphonique. Aussi, afin de modifier le moins possible les dispositifs existants, les informaticiens ont conçu l’ Internet comme un réseau où 1’« intelligence » est repoussée aux extrémités du réseau, c’est-à-dire dans les éléments terminaux.
Ce choix originel est encore un avantage aujourd’hui : de nouvelles applications sont conçues et développées sans qu’il soit nécessaire d’intervenir sur le réseau luimême. Autre conséquence, de nouveaux terminaux peuvent devenir des « terminaux Internet » (aujourd’hui téléphones portables, télévisions..., demain réfrigérateurs qui commanderont eux-mêmes ce qu’il faut pour les remplir) du moment qu’ils sont raccordés à l’ Internet.
Le protocole IP est l’élément fédérateur de l’architecture de l’Internet. Il assure l’adressage (la destination) et le routage (le chemin à parcourir dans le réseau). L’universalité de ce protocole est l’élément fondateur de la dynamique de l’Internet. Elle offre un éventail des possibles dont personne ne perçoit aujour-d’hui les limites. Aussi, lorsque l’on parle de la gouvernance de l’Internet, rappelons-nous qu’il s’agit de quelque chose dont personne ne connaît les limites.
À mesure qu’ils découvraient l’éventail des possibles, les concepteurs de l’Internet et de ses applications ont opté pour une vision où se mêlent intelligence collective, partage des connaissances et communication. Qui intervient dans le développement de l’ Internet ?
Les instances de l’Internet
Créée en 1986, l’IETF (Internet Engineering Task Force), et non l’ICANN comme certains l’affirment souvent, est l’instance de normalisation de l’Internet. Son rôle est multiple : identifier les problèmes urgents opérationnels et techniques et proposer des solutions ; préconiser des protocoles (http, ftp, etc.) et définir les architectures les mieux adaptées à court terme pour résoudre ces problèmes ; favoriser l’échange d’informations entre tous les acteurs de l’Internet (fournisseurs, utilisateurs, chercheurs...). Par exemple, un des derniers problèmes résolus est l’utilisation de l’Internet sur un téléphone portable, car ces appareils n’existaient pas dans les années 1970 lorsque l’Internet a été inventé.
L’IETF est un groupe informel et auto-organisé dont les membres, volontaires (quiconque peut s’inscrire, il n’y a pas d’adhésion officielle), se réunissent physiquement trois fois par an. Les travaux sont menés au sein d’une centaine de groupes, répartis selon une dizaine de domaines d’intérêt. Les membres de ces groupes rédigent des documents, nommés RFC (Request for comments, c’est-à-dire des Demandes de commentaires), soumis à la communauté de l’Internet. Par exemple, la RFC 760, en janvier 1980, décrit le protocole IP utilisé pour le routage des données.
L’Internet Society est une association de droit américain créée en janvier 1992 par les pionniers de l’Internet pour promouvoir et coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde. L’Internet Society fournit l’appui financier et juridique à d’autres groupes, dont l’IETF. L’association regroupe 7 800 membres, de 125 pays, ainsi que 129 organisations.
L’IESG (Internet Engineering Steering Group) regroupe les directeurs de domaines de l’IETF : ils ratifient les résultats issus des groupes de travail de l’IETF, déclarent la création et la dissolution de ces derniers et s’assurent de la qualité des documents non issus des groupes de travail. L’IAB (Internet Architecture Board) planifie à long terme l’activité des différents domaines de compétences de l’IETF.
L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) est l’organisation chargée de l’attribution des adresses et des noms grâce auxquels l’Internet fonctionne harmonieusement. Elle gère les noms de domaines génériques (.com, .org...) et les noms de domaines nationaux (.fr, .de...). Ces dernières années, l’ ICANN a introduit plusieurs nouveaux noms (.asia, .jobs, . post, .travel...). En pratique, l’ICANN délègue l’ attribution concrète des noms de domaines à de nombreuses organisations à travers le monde. Par exemple, la Société VeriSign gère les noms de domaines .com et .net ou l’AFNIC pour le domaine .fr. L’ICANN définit également des procédures pour traiter les conflits, tel l’ usage abusif de marques déposées dans des noms de domaines. Les jugements sont rendus par de nombreuses instances mondiales dont la plus connue est l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle.
Le W3C (World Wide Web Consortium) est l’organisation qui développe les langages (html par exemple) et les protocoles qui définissent le Web. Le W3C regroupe des entreprises ou des organisations à but non lucratif. Une attention particulière est portée sur l’internationalisation, l’accès des personnes handicapées, la protection des données personnelles et la garantie que la mise en œuvre des standards prônés est sans risque pour la propriété industrielle.
La plupart de ces organisations laissent en accès libre leurs statuts et leur mode de fonctionnement. Toute publication importante fait l’objet de consultations publiques dont la trace est disponible. Ces organisations font leur possible pour prendre en compte l’opinion de chacun avant de finaliser leurs décisions. En outre, du fait du caractère évolutif de l’Internet et de ses applications, chacune de ces organisations peut remettre en cause ses décisions à la lumière de l’expérience vécue. Ces modes de fonctionnement ouverts ont inspiré de nombreuses organisations à travers le monde. En France, par exemple, le Forum des droits sur l’Internet et la Fondation pour l’Internet nouvelle génération ont choisi de s’organiser selon ces principes. Le premier est un espace d’information et de débats sur les questions de droit et de société liées à l’Internet. Ses recommandations et ses publications sont destinées aux citoyens. La Fondation s’intéresse aux usages futurs de l’Internet. Elle se propose de repérer, stimuler et valoriser l’innovation en matière d’Internet. Ainsi, l’Internet a construit au fil du temps des organisations et des méthodes de gouvernance à la fois adaptées et adaptables.
Depuis l’avènement du World Wide Web, qui a sorti l’ Internet des entreprises et des universités, et après une période de fièvre économique, l’Internet est désormais accessible dans plus de la moitié des foyers aux ÉtatsUnis et en Océanie, et dans plus du tiers des foyers en Europe. Le déploiement s’est plus récemment accéléré en Asie et en Amérique latine pour atteindre 10 % des foyers, fin 2005. Enfin, parmi le milliard d’habitants en Afrique, seuls 22 millions utilisent l’Internet. Au total, plus d’un milliard de personnes, soit 15 % de la population mondiale, sont reliées à l’Internet en 2006 alors qu’il était pratiquement inconnu du grand public en 1993, quand Mosaic, le premier navigateur Web, fut disponible pour l’ensemble des ordinateurs individuels.
Outre l’expansion mondiale, les usages de l’Internet prennent de nouvelles formes chaque jour. Chaque individu peut, bien sûr, chercher - et souvent trouver - sur le Web l’information dont il a besoin. Cet usage désormais courant a fait la fortune de sociétés telles que Google. Récemment, l’arrivée des blogs a facilité la publication individuelle sur l’Internet. Au même moment, l’émergence des wikis (un site Web dynamique que tout individu peut modifier. Le nom wiki vient du terme hawaiien wiki wiki, qui signifie « rapide ») permet à des communautés réparties dans le monde de partager informations et expériences, ainsi que d’organiser leurs débats ou travaux en commun. Cet environnement a même donné une nouvelle jeunesse aux idées de Diderot et de d’Alembert avec le déploiement de Wikipedia, la première encyclopédie conçue de façon collective (la revue Nature a récemment reconnu qu’elle était au moins aussi fiable que la vénérable encyclopédie Britannica). En sus de l’universel courrier électronique et de l’intranet (réservé aux membres d’une organisation), les entreprises utilisent de plus en plus les techniques telles que les wikis comme outil de coopération interne.
Encyclopedie en ligne
Pour les entreprises plus importantes, la gestion de l’information est devenue une clef du succès. Les applications dites de gestion, autrefois exclusivement hébergées par des grands ordinateurs, sont désormais souvent distribuées. Dans ce cadre, l’interaction des applications existantes ou à venir se construit selon des techniques issues de l’Internet.
Le commerce électronique a suscité l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché ou autorisé des acteurs existants à offrir de nouveaux services. La croissance espérée (trop tôt) à la fin des années 1990 est désormais au rendez-vous.
Au-delà de la création de nouveaux services, l’Internet modifie les pratiques existantes. Dans le domaine de l’ éducation, par exemple, une récente étude a montré comment l’enseignement dans les universités devra être remanié puisque les étudiants entrent désormais dans les salles de cours avec une connaissance (acquise sur le Web) qui est sans commune mesure avec celle des étudiants « d’avant l’Internet ».
Enfin, les progrès en matière de puissance des ordinateurs (et donc des éléments du réseau), de bande passante des infrastructures de communication (fixes et mobiles) et l’évolution des protocoles et des logiciels seront tels que l’usager aura accès au texte, à l’image et au son, mais aussi à l’image animée de haute définition.
L’Internet est ainsi appelé à devenir la plateforme de la convergence entre l’ informatique, les télécommunications et l’audiovisuel. En conséquence, gouverner l’Internet consistera bientôt à gérer des activités intimement liées alors qu’elles étaient autrefois indépendantes et donc gérées par des organisations et des méthodes distinctes.
Toutefois, les succès, les promesses et les initiatives créatrices voisinent avec les menaces, les risques et les obstacles. Comme toute activité humaine, l’usage de l’Internet a des facettes plus sombres. Dès le déploiement du Web, la question du filtrage des contenus s’est posée, pour de bonnes raisons (contenus illégaux, diffamatoires ou simplement inexacts) ou de moins bonnes telles que la censure.
Les risques de l’Internet
La jeunesse de l’infrastructure et des applications a posé rapidement des problèmes en termes de sécurité des informations, d’authentification des personnes et des services. L’usage de données personnelles partagées avec des fournisseurs de services a fait l’objet de débats au niveau international, les législations étant différentes d’un côté à l’autre de l’Atlantique. Plus récemment, les questions de propriété industrielle (brevets, logiciels) et intellectuelle (droits d’auteur) ont suscité des débats passionnés. On peut également citer les récentes affaires Yahoo et Google. La première société a dénoncé aux autorités chinoises l’identité d’un dissident, tandis que la seconde a accepté, toujours en Chine, de restreindre les informations disponibles aux internautes.
Enfin, l’usage déséquilibré de l’Internet d’une région à l’autre de la planète augmente les écarts entre ceux qui ont accès et ceux qui ne l’ont pas. La « fracture numérique » constitue sans doute la question la plus difficile à traiter. Sa résolution demande, en effet, une concertation mondiale relevant simultanément des techniques, de l’économie, de la politique et du social. Durant le Sommet mondial de la société de l’information (SMSI), qui s’est tenu à Tunis en novembre 2005, les enjeux du développement de l’Internet ont été reconnus. Les débats avaient pour objet principal les conséquences de l’émergence de la société de l’information sur les équilibres mondiaux. Parmi les décisions prises, figure la création de l’IGF (Internet Governance Forum) dont le rôle, sous l’égide des Nations unies, est de traiter collectivement les questions clés relatives au développement de l’Internet dans le monde. La première réunion de ce Forum doit avoir lieu à Athènes en 2006.
En marge du sommet de Tunis, la controverse relative aux responsabilités et aux statuts de l’ICANN a fait l’ objet de nombreuses prises de position. En effet, selon certains, la position de l’ICANN est ambiguë, car sa compétence est mondiale alors qu’elle est régie par la loi californienne. En outre, le Département du Commerce américain a un droit de veto sur ses décisions. De nombreux pays aimeraient que les fonctions assurées par l’ ICANN soient prises en charge par un organisme relevant des Nations unies. D’autres préféreraient une organisation coopérative où la société civile serait représentée. Beaucoup espèrent que l’IGF ouvrira la voie à une internationalisation progressive de la gouvernance de l’ Internet.
La vivacité du débat a conduit à évoquer l’hypothèse d’ un contrôle des opérations de l’Internet : autrement dit, peut-on « couper l’Internet » ? Cette hypothèse n’est pas réaliste. D’abord, l’Internet est conçu de façon à n’avoir aucun point central : si une route entre deux points est coupée (par une panne, par exemple), le protocole de routage identifie immédiatement une autre route praticable. Seules les régions du monde où le maillage de l’ Internet est encore limité sont ainsi fortement sensibles aux incidents du réseau.
Sans minimiser le rôle important joué par l’ICANN (c’est-à-dire l’importance de la disponibilité et la robustesse d’un système de nommage et d’adressage pour l’ Internet à l’échelle mondiale), il n’est pas raisonnable d’ y voir le problème central de l’Internet. Le système fonctionne et répond à la demande (ce qui est remarquable au vu de son ancienneté). Enfin, un mauvais fonctionnement du système de nommage serait dommageable aux pays et aux organisations qui utilisent le plus l’Internet dans leur vie de tous les jours. Compte tenu du nombre d’internautes et de leur proportion par rapport à la population totale, les États-Unis seraient les premiers pénalisés si le système ne fonctionnait pas normalement.
Une autre erreur à ne pas commettre est d’imaginer que l’heure est venue de légiférer et de faire rentrer dans les moules existants une infrastructure qui ne ressemble à aucune autre. Pour les responsables et les acteurs de l’ Internet, l’heure est au dialogue, à l’expérimentation, à la construction.
Une bonne gouvernance
Ainsi, l’on peut classer les priorités en quatre catégories, dont la première est le déploiement de l’Internet. Les défis sont de nature technique, économique et politique (déploiement des infrastructures, internationalisation, investissements...). Une part des problèmes tient également à la disponibilité de standards ouverts, libres de droit, de façon à encourager le développement de nouvelles applications. Plus généralement, les questions de propriété intellectuelle doivent être traitées en tenant compte de la baisse des coûts de diffusion et de la croissance du marché atteignable.
Proche de la question du déploiement est le défi de la facilité d’utilisation. Malgré les efforts accomplis, l’usage de l’Internet n’est pas encore facile pour tout le monde. En particulier, si les navigateurs ont rendu accessible l’ accès à l’information (la lecture), la fonction d’auteur (l’ écriture) est encore réservée à une minorité. Sur ce point aussi, les questions de propriété intellectuelle se posent puisque le travail créatif a, pour une bonne part, un caractère collectif.
La troisième priorité est la création d’un Internet de la confiance. Les risques bien réels évoqués précédemment doivent faire l’objet de réflexions et d’actions collectives. L’implication des États est essentielle, car les législations sont souvent différentes, voire contradictoires, et l’universalité de l’Internet affaiblit l’effet des actions locales.
Enfin, les modèles économiques doivent être eux aussi adaptés pour répondre aux demandes spécifiques de l’ Internet. Les règles du commerce électronique, la gestion des taxes sur les échanges et la question des droits numériques demandent une concertation internationale aux contours complexes.
Gouverner l’Internet nécessite donc d’associer de nombreux acteurs aux compétences diverses. Pour que l’Internet progresse, la gouvernance doit être au service des citoyens. Elle doit d’abord être légitime. Les organisations impliquées doivent s’engager à prendre en compte les besoins de l’ensemble de la population mondiale. L’ internationalisation des produits et des services, le support d’infrastructures de toutes formes, l’accès pour les personnes handicapées, doivent figurer dans les priorités de chaque organisation responsable.
Ensuite, la gouvernance doit être démocratique. Les organisations impliquées doivent s’engager à rendre leurs débats et les résultats de leurs travaux accessibles à tous. L’Internet, lui-même, doit être utilisé systématiquement pour faciliter le dialogue et l’échange d’informations ou de logiciels ainsi que le développement de nouvelles applications adaptées aux besoins de chacun.
Enfin, la gouvernance doit être efficace. Les principes qui ont présidé au déploiement de l’Internet doivent être préservés, voire amplifiés. La principale force de l’Internet est sa capacité à offrir des espaces de création. C’est de cette force qu’est venue son efficacité. C’est de cette force que viendront les solutions aux difficiles problèmes auxquels l’Internet est confronté aujourd’hui et le sera demain.
Internet -